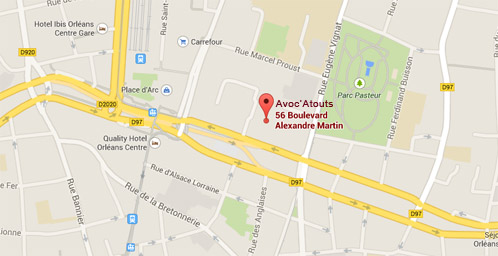Actualité juridique du cabinet d'avocat à orleans

31/07/2024
Droit du sport
Lorsqu’un club accueille un joueur professionnel sous la forme d’un prêt, il doit lui faire signer en CDD, à défaut, le contrat sera requalifié en CDI
C’est l’apport de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 juin 2024 au détriment du MHR (Montpellier Hérault Rugby), déjà en délicatesse sur les terrains de rugby, il l’est également sur le terrain judiciaire.
Dans les faits, un joueur professionnel du Club Aviron bayonnais sous CDD est prêté via une convention tripartite (club prêteur, joueur, club emprunteur) au MHR.
Tous les acteurs pensaient que cette convention était suffisante mais pas la Cour d’appel dont le raisonnement est validé par le Cour de cassation.
En effet, conformément à l’article L222-2-3 du Code du sport, toute relation contractuelle même temporaire et via un prêt doit être un contrat à durée déterminée et, à défaut d’avoir rédigé un contrat conforme à l’article L222-2-5, le contrat liant le joueur prêté au club emprunteur est un contrat à durée indéterminée (CDI).
Cette interprétation s’applique dans tous les sports, pour tout prêt de joueur un nouveau CDD doit être signé !
Nous invitons les acteurs du sport professionnel à la plus grande vigilance, que ce soit les clubs (pour éviter une requalification) ou les sportifs (pour obtenir la requalification).
13/06/2024
Droit du travail
Employeurs ne soyez pas trop humain avec les salariés que vous licenciez !
C’est malheureusement le conseil à donner aux employeurs depuis l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 avril 2024 (pourvoi n°23-10.931).
Nous savons depuis longtemps que le licenciement verbal est sans cause réelle sérieuse et qu’informer oralement un salarié de son licenciement avant l’envoi de la lettre de licenciement était prohibé.
En revanche, informer le salarié après l’envoi de la lettre recommandée est autorisé (Soc. 28 septembre 2022, pourvoi n°21-15.606 – lettre de licenciement envoyée avant l’appel téléphonique).
Dans l’arrêt du 3 avril 2024, le DRH a informé le salarié de son licenciement par courtoisie pour éviter une situation humiliante au travail lendemain (en étant renvoyé chez lui devant les anciens collègues), le jour même de l’expédition de la lettre de licenciement.
Cependant, l’employeur était dans l’incapacité de prouver que l’expédition était antérieure à l’appel téléphonique.
Les employeurs n’ont que deux solutions :
- ne pas faire preuve de gentillesse auprès des salariés qu’ils licencient
- demander à la poste une attestation ou une facture spécifique mentionnant l’heure du dépôt de la lettre de licenciement et n’informer téléphoniquement le salarié qu’après ce dépôt
Personnellement, je préfère la seconde !
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049385404?init=true&page=1&query=23-10931&searchField=ALL&tab_selection=all
20/09/2023
Droit du travail
Alerte sur les congés payés – révolution en cas d’arrêt de travail et sur le point de départ du délai de prescription
Dans plusieurs arrêts en date du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d’écarter le droit français contraire au droit de l’Union européenne avec des conséquences incroyablement positives pour les salariés et surtout immensément négatives pour les employeurs.
Tout d’abord, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail mais durera tout l’arrêt maladie. Autant dire que le salarié licencié pour inaptitude professionnelle après 3 ans d’arrêt de travail va recevoir dans le cadre de son solde de tout compte l’équivalent de 90 jours de congés payés. L’employeur doit anticiper du point de vue de la trésorerie !
Ensuite et surtout, les salariés malades ou accidentés auront désormais droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Enfin, outre que cela s’applique aux situations existantes, la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile. Exemple : votre salarié est en arrêt maladie depuis 5 ans, le délai de prescription de 3 ans n’a jamais pu courir, donc l’employeur doit comptabiliser 5 ans fois 30 jours de congés payés soit 150 jours de congés payés à son retour d’arrêt maladie. Si le salarié est licencié pour inaptitude non professionnelle, l’employeur doit payer intégralement ces 150 jours de congés payés.
Le plus dur n’est pas de s’adapter au droit de l’UE, c’est de s’y adapter du jour au lendemain !
02/08/2023
Accords collectifs de branche illicites sur le forfait annuel en jours
Depuis un arrêt du 29 juin 2011 (pourvoi n°09-71.107), la Cour de cassation tient à vérifier que les accords de branche qui permettent la mise en place d’un forfait annuel en jours assurent une protection efficace de la sécurité et de la santé du travailleur.
Elle se fonde pour cela sur de nombreux textes, notamment la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ce qui illustre une nouvelle fois la volonté récente de la plus haute juridiction civile de viser les normes européennes dans ses décisions.
De nombreuses conventions collectives ont été déclarées illicites par la Cour de cassation :
– convention collective nationale des industries chimiques et connexes (Soc. 31 janvier 2012, pourvoi n°10-19.807)
– convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (Soc. 14 mai 2014, pourvoi n°12-35.033 ; 17 novembre 2021, pourvoi n°19-16.756)
– accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises de bâtiment et travaux publics (Soc. 11 juin 2014, pourvoi n°11-20.985) mais la convention collective du bâtiment a, par avenant n°3 du 11 décembre 2012, réussit à se conformer aux exigences légales (Soc. 5 juillet 2023, pourvoi n°21-23.294)
– convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Soc. 4 février 2015, pourvoi n°13-20.891)
– convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dit Syntec (Soc. 6 octobre 2015, pourvoi n°13-17.250)
– convention collective nationale de l’immobilier (Soc. 14 décembre 2016, pourvoi n°15-22.003)
– convention collective des avocats salariés (Soc. 8 novembre 2017, pourvoin°15-22.758) mais corrigée par Avenant n ° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait annuel en jours
– convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (Soc. 16 octobre 2019, pourvoi n°18-16.539) corrigée par l’avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes
– convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (Soc. 14 décembre 2022, pourvois n°20-20.572 et 21-10.251) corrigée par avenant du 9 mai 2012
– convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (Soc. 5 juillet 2023, pourvoi n°21-23.387)
– convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et convention collective du contrôle technique automobile (Soc. 5 juillet 2023, pourvoin°21-23.222)
Si vous êtes employeurs relevant d’une convention collective non corrigée, les conséquences peuvent être financièrement désastreuses. En effet, le conseil de prud’hommes va déclarer la convention individuelle de forfait nulle et va vous condamner à payer toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Comment éviter ces conséquences ? Tout d’abord, l’article L3121-63 du Code du travail (ancien L3121-39) dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Pour éviter toute difficulté, il suffit donc de faire voter un accord d’entreprise respectant les exigences légales : veiller aux éventuelles surcharges de travail, au respect des durées minimales de repos, créer un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés, point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice… Il est préférable d’être accompagné par un cabinet d’avocat en droit du travail pour sa rédaction.
Ainsi, même si l’accord ou la convention de branche devait être illicite, votre accord d’entreprise licite vous prémunit de la nullité de la convention individuel de forfait.
Ensuite, l’autre possibilité est de faire un avenant au contrat de travail en supprimant le forfait et en transigeant sur les conséquences de la nullité de la clause. Pour faire simple, vous vous protégez pour l’avenir et, s’agissant du passé, contre une indemnité transactionnelle vous mettez fin à toute incertitude prud’homale.
Dans tous les cas, si vous avez recours au forfait dans l’entreprise, il est nécessaire de faire un audit social.
26/04/2023
Droit du travail
La présomption de démission en cas d’abandon de poste
C’était attendu, la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié est entrée en vigueur le 19 avril 2023.
En effet, l’article R1237-13 du Code du travail a été créé par décret du 17 avril 2023, il permet l’application de l’article L1237-1-1 du même code qui a institué la présomption de démission en cas d’abandon de poste.
Concrètement, en cas d’abandon de poste, l’employeur ne doit plus licencier pour faute ou faute grave. Il doit mettre en demeure son salarié de reprendre son poste et donner la raison de l’absence dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée. Si le salarié ne répond pas à la mise en demeure ou répond qu’il ne reprendra pas le travail, il sera considéré démissionnaire à la date fixée dans la mise en demeure.
Exemple : mon salarié est absent sans justificatif depuis le 1er avril 2023. Je le mets en demeure par courrier du 25 avril 2023 de reprendre son poste et de justifier de ses absences sous quinzaine. En l’absence de réponse positive le mercredi 10 mai inclus, la démission est présumée à cette date. Le préavis doit être exécuté à compter du 11 mai 2023, à défaut, le salarié est en absence injustifiée. A l’expiration du préavis les documents de fin de contrat doivent être adressés au salarié.
4 précisions importantes :
– le salarié ne bénéficiera pas du chômage (aide au retour à l’emploi)
– si le salarié justifie dans le délai d’un motif légitime (maladie, droit de retrait…), il faut mettre fin à la procédure de démission présumée
– si tous les conditions ne sont pas remplies, il faut procéder comme avant par un licenciement disciplinaire pour faute ou faute grave
– l’employeur n’est pas obligé d’engager cette procédure et peut conserver le salarié dans les effectifs et sans le payer en apposant la mention “absence injustifiée” sur les bulletins de paie
22/02/2023
Droit du travail
Alerte sérieuse sur les contrats de travail à temps partiels modulés des producteurs de Champagne
Dans deux arrêts du 8 février 2023, la Cour de cassation a jugé que la convention collective régionale des vins de champagne du 9 juillet 1985 comportait des dispositions illicites sur la modulation du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.
En effet, en principe le temps de travail d’un salarié est décompté à la semaine, notamment pour le calcul des heures supplémentaires. Il peut y être dérogé par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise avec par exemple une modulation du temps de travail annuelle (= le temps de travail est décompté à l’année). S’agissant des salariés à temps partiel, le temps de travail peut être modulé dans les même conditions mais l’accord doit prévoir le mode de communication et de modification de la répartition de la durée et des heures de travail.
L’objectif est de permettre à un salarié à temps partiel de cumuler un autre temps partiel s’il le souhaite et donc d’adapter ses horaires dans son ou ses autres emplois.
Or, les articles B131 à B133 de la convention collective régionale des vins de champagne du 9 juillet 1985 ne satisfont pas à ces exigences.
En conséquence, les salariés à temps partiel peuvent prétendre au paiement des heures complémentaires effectuées chaque semaine.
Si tous les salariés à temps partiel des vins de champagne attaquent leurs employeurs, la facture peut être colossale. Est-ce que ces arrêts vont provoquer une hausse des prix ? En tout cas cette nouvelle ne donnera pas envie aux propriétaires de sabrer le champagne !
Source : Soc. 8 février 2023, pourvoi n°21-20.553 et 21-20.554
25/01/2023
Droit du travail
Evolution jurisprudentielle du temps de trajet domicile-travail du salarié itinérant
La Cour de cassation vient d’opérer une évolution dans sa jurisprudence relative au temps de trajet du salarié itinérant entre son domicile et son premier client dans un arrêt du 23 novembre 2022.
Jusqu’à présent la Cour avait toujours considéré que ce temps de trajet très particulier n’était pas du temps de travail effectif. il pouvait éventuellement faire l’objet d’une contrepartie s’il excédait le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel (par exemple 45 minutes dans un bassin d’emploi en province).
Pour la première fois, en s’aidant du droit de l’Union européenne et plus particulièrement de la directive du 4 novembre 2003, la Cour de cassation a reconnu que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client était du temps de travail effectif.
Cependant les faits étaient spécifiques, le salarié était réellement à la disposition de son employeur pendant ses trajets puisqu’à l’aide de son téléphone portable et du kit main libre, il contactait les clients, leur fixait des rendez-vous et répondait à divers interlocuteurs (techniciens, assistantes, directeur commercial…).
Jamais la Cour de cassation n’avait eu à traiter un tel cas, il s’agissait donc d’une question juridique nouvelle et non d’un revirement de jurisprudence contrairement à ce qui a pu être indiqué par certains commentateurs.
Il s’agit d’une évolution et elle est parfaitement conforme à l’article L3121-1 du Code du travail.
Source : Soc. 23 novembre 2022, pourvoi n°20-21.924 – FP-B+R cassation https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb6714982305d4c204de
24/11/2022
Droit du travail
La Cour de cassation juge qu’un homme a le droit de se coiffer comme une femme quel que soit son travail
La lutte contre les discriminations fondées sur le sexe au travail cible quasi-systématiquement les ruptures d’égalité défavorable aux femmes.
Dans l’arrêt du 23 novembre 2022, non seulement la Cour de cassation sanctionne une discrimination fondée sur le sexe dont a été victime un homme, mais en outre, elle a fait preuve de modernité en balayant des codes, pourtant retenus par les juridictions du fond, qui impliquerait que des femmes pourraient avoir une coiffure (tresses africaines) et pas des hommes.
En l’espèce, un steward a été sanctionné pour avoir refusé de respecter le manuel de la compagnie qui autorisait les femmes à être coiffées de tresses africaines mais l’interdisait aux hommes.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel parce que les exigences de la profession de steward ne justifiaient pas d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes.
Même au travail, chacun est libre de se coiffer comme il le souhaite !
Source : Soc. 23 novembre 2022, pourvoi n°21-14.060 – FP-B+R – communiqué de la Cour de cassation sur https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/11/23/steward-sanctionne-par-sa-compagnie-aerienne-pour-le-port-dune?date_du=&date_au=&thematique%5B0%5D=1363&items_per_page=10&sort_bef_combine=created_DESC
16/05/2022
Droit du travail
Par deux arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que le barème “macron” doit s’appliquer dans tous les cas prévus
Le 11 mai 2022, la Cour de cassation aurait enfin tranché la question de la conformité du barème dit “Macron” sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (abusif). Ce que la presse et certains commentateurs ont présenté comme étant la fin d’une saga judiciaire n’est en réalité qu’une redite du 17 juillet 2019. Il ne s’agit que d’une décision réchauffée que la Cour de cassation a elle-même tenté de présenter comme une nouveauté en publiant un communiqué.
Pourtant le juriste averti ne s’y trompera pas.
Tout d’abord la formation de jugement était certes significative pour les deux arrêts du 11 mai 2022, il s’agissait d’une formation plénière de chambre réunissant tous les conseillers de la chambre sociale, mais en comparaison de la formation plénière pour avis qui a notamment réuni le premier président de la Cour de cassation et les six présidents de chambre lors de l’avis du 17 juillet 2019, on comprend que la portée n’est pas la même.
Ensuite et surtout, ces deux arrêts du 11 mai 2022 ne dévient pas et n’apportent rien par rapport à l’avis du 17 juillet 2019. Aux mêmes moyens, les mêmes réponses sont apportées : les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct (bien que le Conseil d’Etat ait déjà jugé le contraire) et le barème n’est pas incompatible avec la convention n°158 de l’OIT.
Pourquoi la Cour de cassation présente-t-elle ces arrêts comme étant importants ? Tout simplement parce qu’elle espère faire cesser la fronde de certains juges du fond qui malgré l’avis du 17 juillet 2019 continuaient d’écarter le barème ou considéraient qu’au cas par cas, avec une appréciation in concreto, il pouvait être écarté. En effet, ce barème a deux défauts. Il est contre nature parce qu’il va à l’encontre de l’appréciation souveraine des juges du fond concernant l’appréciation du préjudice subi. Le second défaut est qu’il est nécessairement injuste puisque son objectif est de limiter le risque prud’homal de l’employeur et donc l’indemnisation du préjudice subi par le salarié. Cela ne changera pas quel que soit le nombre d’arrêts que pourrait rendre la Cour de cassation !
Source : Soc. 11 mai 2022, pourvoi n°21-14490 et 21-15247, FP-B+R
31/03/2022
Droit du travail
L’employeur ne peut pas modifier les congés moins d’un mois avant la date prévue, quel que soit les congés (5e semaine, jours d’ancienneté, RTT…)
L'article L3141-16 2° du Code du travail dispose que l'employeur ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre ou les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Ces dispositions s'appliquaient indiscutablement aux 4 premières semaines de congés payés. Progressivement la Cour de cassation a étendu leur application à la 5e semaine de congés payés, puis aux congés d'origine conventionnelle et aux employeurs relevant de caisse de congés payés.
Il résulte de l'arrêt du 2 mars 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qu'il faut désormais considérer que l'interdiction de modifier les congés moins d'un mois avant le départ du salarié s'applique à tous les congés, ce compris les jours de repos, les jours d'ancienneté ou encore les RTT.
Deux tempéraments subsistent : les circonstances exceptionnelles (par exemple une fermeture imposée par les pouvoirs publics) et un accord collectif qui peut prévoir un délai inférieur à un mois.
Source : Soc. 2 mars 2022, pourvoi n°20-22261, FS-B
30/11/2021
Droit du travail
Mentions obligatoires sur le contrat de travail à temps partiel
L’ancien article L3123-14 devenu L3123-6 du Code du travail impose de mentionner sur le contrat de travail à temps partiel « la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue » et « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».
Jusqu’à maintenant, l’absence de l’une ou l’autre de ces mentions avait pour conséquence une présomption d’emploi à temps complet que l’employeur pouvait combattre en prouvant la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Dans un arrêt du 17 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation semble opérer un revirement. Son attendu de principe est le suivant : « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».
Elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait débouté le salarié de sa demande de requalification à temps plein « alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».
Cela signifie-t-il que le contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et/ou la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera désormais automatiquement requalifié à temps complet ?
En l’absence de communiqué de la chambre sociale il n’y a pas de certitude mais les rédacteurs de contrat de travail à temps partiel doivent faire preuve de prudence…
Source : Soc - 17 novembre 2021, pourvoi n°20-10734, FS-B
22/07/2021
Droit du travail
Respect des libertés individuelles et de la vie privée du salarié
Peut-on filmer son salarié en permanence sans justifier d’un motif impérieux pour la sécurité des personnes et biens ?
La réponse apportée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2021 est négative.
En l’espèce, une pizzeria employait une personne qui travaillait seule en cuisine. Pour de prétendues raisons de sécurité, l’employeur filmait en permanence son salarié et a utilisé des enregistrements pour justifier son licenciement pour faute grave.
La cour d’appel a jugé que ces enregistrements n’étaient pas opposables aux salariés, c’est-à-dire qu’ils devaient être écartés des débats comme étant irrecevables, parce qu’ils étaient attentatoires à la vie personnelle du salarié et disproportionnés au but allégué.
C’est l’occasion pour la plus haute juridiction de rappeler que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Un employeur peut bien entendu filmer les couloirs, les pièces accessibles aux clients ou les pièces de stockage en prenant soin d’informer les salariés, mais il ne peut pas filmer en permanence un ou des salariés qui occupent une pièce telle qu’un bureau ou, comme dans le cas évoqué, une cuisine.
Source : Soc - 23 juin 2021, pourvoi n°19-13856, FS-B
04/01/2021
Contrat et obligations conventionnelles
Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation fait une interprétation très littérale de l’article 1218 du Code civil et de la force majeure.
En effet, selon la plus haute juridiction judiciaire, seul le débiteur d’une obligation peut invoquer la force majeure pour échapper à ses obligations.
En l’espèce, un couple a dû mettre fin à leur séjour thermal suite à l’hospitalisation en urgence de l’époux en cours de séjour. Ils ont agi en justice et obtenu la résolution du contrat d’hébergement pour cause de force majeure et la restitution d’une partie du prix.
Cependant l’article 2018 alinéa 1 du Code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
Seul le débiteur de l’obligation peut invoquer la force majeure, pas le créancier.
On ne peut que s’interroger sur la pertinence d’une interprétation aussi littérale.
Cela signifie que le créancier d’une obligation telle qu’un contrat d’hébergement doit veiller à la rédaction du contrat en y incluant par exemple une extension de la force majeure à son profit (l’hébergé dans l’exemple) ou souscrire une assurance afin d’être remboursé en cas d’annulation de tout ou partie du séjour.
Le consommateur n’est pas si bien protégé !
Source : Civ I - 25 novembre 2020, pourvoi n°19-21.060 FS-P+B+I
09/11/2020
Licenciement motif économique consécutif à une réorganisation de l’entreprise
Faute de l’employeur - Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans un arrêt « Pages jaunes » du 4 novembre 2020, la chambre sociale de Cour de cassation a apporté des précisions sur l’appréciation du bien-fondé du licenciement économique consécutif à une réorganisation de l’entreprise.
S’il revient au juge de vérifier la réalité d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève (Soc., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-47.376, Bull. 2006, V, n° 200 ; Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.869), il ne lui appartient pas de se prononcer sur la cause du motif économique (Soc., 1 mars 2000, pourvoi n° 98-40.340, Bull. 2000, V, n° 81) et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de l’employeur et leurs conséquences sur l’entreprise (Ass. plén. 8 décembre 2000, pourvoi n° 97-44.219, Bull. 2000, Ass. plén., n° 11 ; Soc., 27 juin 2001, n°99-45817 ; Soc 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-40.046, Bull. 2009, V, n° 173 ; Soc., 24 mai 2018, pourvois n°16-18.307 et s.).
Toutefois, la chambre sociale juge traditionnellement que l’employeur ne peut se prévaloir d’une situation économique qui résulte d’un “attitude intentionnelle et frauduleuse” de sa part ou “d’une situation artificiellement créée résultant d’une attitude frauduleuse” (Soc., 9 octobre 1991, pourvoi n° 89-41.705, Bull. n°402 ; Soc., 13 janvier 1993, pourvoi n° 91-45.894, Bull. n°9 ; Soc., 12 janvier 1994, pourvoi n° 92-43.191).
Ainsi, jugeait-elle que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques, même établies, sont imputables à la légèreté blâmable de l’employeur (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n°14-15.520).
Elle a ensuite retenu, dans un arrêt dit Keyria, que lorsque les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement d’un salarié résultent d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc. 24 mai 2018, n°17-12560, Bull. V n°85).
La chambre sociale a depuis longtemps transposé cette règle dans le domaine de la cessation d’activité, lorsque la faute de l’employeur en est à l’origine (Soc., 16 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.647, Bull. 2001, V, n° 10 ; Soc., 23 mars 2017, pourvoi n° 15-21.183, Bull. 2017, V, n° 56), l’étendant récemment à l’hypothèse où la cessation d’activité résulte de la liquidation judiciaire de l’entreprise (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.140, publication en cours).
La question posée en l’espèce à la chambre était de savoir si cette solution était transposable à cet autre motif économique que constitue la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. En effet, la frontière avec les choix de gestion de l’employeur, sur lesquels le juge n’a pas à porter une appréciation, paraît plus ténue en matière de réorganisation que de difficultés économiques, ce qui pouvait interroger sur la possibilité pour le juge de se prononcer sur l’existence d’une faute de l’employeur privant de cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé à la suite d’une réorganisation.
La règle semblait cependant avoir été implicitement admise, aux termes d’un arrêt simplement diffusé censurant une cour d’appel qui, pour juger sans cause réelle et sérieuse des licenciements fondés sur une menace sur la compétitivité, avait retenu comme fautifs des faits constituant des choix de gestion (Soc., 21 mai 2014, pourvoi n° 12-28.803).
Le pourvoi formé par la société Pages jaunes contre les arrêts de la cour d’appel de Caen était l’occasion pour la Cour de cassation d’admettre, pour la première fois, qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation était susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés. Mais la chambre sociale rappelle que l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.
Les arrêts attaqués sont censurés, la cour d’appel ayant seulement caractérisé la faute de l’employeur par “des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires”, en l’occurrence les remontées de dividendes de la société Pages jaunes vers la holding qui permettaient d’assurer le remboursement d’un emprunt du groupe résultant d’une opération d’achat avec effet levier (LBO).
La chambre sociale, quel que soit le motif économique du licenciement et, a fortiori, lorsqu’il réside dans une réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité, reste vigilante à ce que, sous couvert d’un contrôle de la faute, les juges du fond n’exercent pas un contrôle sur les choix de gestion de l’employeur (Soc., 14 décembre 2005, pourvoi n°03-44.380, Bull n° 365).
Source : Soc. 4 novembre 2020, pourvois n°18-23.029 à 18-23.033, FS-P+B+R+I
02/10/2020
Preuve de la violation de l’obligation contractuelle de confidentialité par le salarié
Production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié
Dans un arrêt destiné à une très large publication (P+B+R+I), la Cour de cassation considère, en vertu des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le salarié avait publié sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été présentée exclusivement aux commerciaux de la société.
Le procédé d’obtention de la preuve n’a été jugé déloyal parce que c’est un autre salarié, « ami » Facebook, qui a transmis à l’employeur la publication. L’employeur n’a donc pas créé au faux compte pour l’obtenir.
Il s’agit d’une nouvelle illustration de ce que la vie privée du salarié n’est pas protégé sur les réseaux sociaux et peut entrainer des conséquences sur les relations contractuelles en droit du travail.
Source : Soc. 30 septembre 2020, pourvoi n°19-12.058, FS-P+B+R+I
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/779_30_45529.html
25/08/2020
Taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes
À compter du 1er septembre 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes passe de 4.000 € à 5.000 €.
Cela signifie que lorsque les demandes (du salarié le plus souvent) sont inférieures à 5.000 €, les parties (l’employeur ou le salarié) ne pourront pas interjeter appel. La seule voie de recours sera le pourvoi en cassation si le conseil a commis une erreur de droit.
15/07/2020
Pas de sanction autre que le licenciement sans règlement intérieur opposable
L’article L1311-2 du Code du travail impose l’établissement d'un règlement intérieur dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés (depuis le 1er janvier 2020, auparavant il s’agissait d’au moins de vingt salariés).
Dans un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation rappelle qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur soumis à l’obligation d’établir un règlement intérieur que si elle est prévue par ce règlement intérieur et si ce règlement intérieur est opposable au salarié, c’est-à-dire mis à sa disposition.
Si vous êtes employeur de plus de 50 salariés, sans règlement intérieur opposable, vous ne pouvez prononcer aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement.
Source : Soc. 1er juillet 2020 n°18-24556- F-D
10/07/2020
Le port de la barbe en entreprise - libertés et droits fondamentaux du salarié
Un employeur a licencié pour faute grave un salarié en lui reprochant le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politique ». La Cour d’appel a considéré ce licenciement pour motif discriminatoire nul. L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
L’occasion pour la chambre sociale de la Cour de cassation de poursuivre l’élaboration de sa jurisprudence relative aux libertés et droits fondamentaux du salarié dans l’entreprise.
Elle a commencé par rappeler les règles énoncées par son arrêt de principe du 22 novembre 2017 (pourvoi n° 13-19.855, Bull. 2017, V, n° 200), rendu sur question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du Code du travail, mettant en œuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
En principe, l’employeur peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.
Cependant, et c’est l’apport de cet arrêt, les demandes d’un client relatives au port d’une barbe pouvant être connotée de façon religieuse ne sauraient, par elles-mêmes, être considérées comme une exigence professionnelle et déterminante au sens de la directive (jurisprudence de la CJUE) et seul un objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut justifier des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et, par suite, permettre à l’employeur d’imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif.
En d’autres termes, à moins que le porte de la barbe ne soit objectivement dangereux, il ne peut pas être interdit par l’employeur.
Sources :
Soc. 8 juillet 2020 n°18-23743, FS-P+B+R+I
Note explicative relative à l’arrêt n°715 du 8 juillet 2020
05/06/2020
CSP : le motif économique doit être énoncé pendant la procédure de licenciement pour que le licenciement soit fondé
Lorsqu’un document écrit a été remis au salarié lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail, précisant le motif économique de cette modification, mais qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture ne lui a été remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) « doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ». Aussi, souligne la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020, l’employeur est-il « tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation » (V. déjà Cass. soc., 30 nov. 2017, n° 16-23.496, inédit).
Dans l’affaire en cause, les juges du fond avaient constaté qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement. Deux lettres lui avaient bien été adressées, mais lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail. Les juges du droit ont décidé que la cour d’appel « en a exactement déduit » que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation légale d’informer la salariée du motif économique de la rupture et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, l’employeur doit pouvoir justifier qu’il a porté à la connaissance du salarié les motifs précis de son licenciement pour motif économique, les répercussions de ces difficultés sur son emploi et les démarches entreprises en vue de son reclassement avant l’acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle. À défaut, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Peu importe la remise au salarié, lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail, d’un document écrit précisant le motif économique de cette modification ; doit impérativement être remis ou adressé au salarié un écrit énonçant la cause économique de la rupture et ce, au plus tard au moment de l’acceptation de la convention.
L’arrêt décide que cette information écrite ne peut pas être délivrée avant que soit engagée la procédure de licenciement.
Sources : Soc. 27 mai 2020 n° 18-24531 - F-P+B
Dépêches JurisClasseur - Actualités
JCl. Travail Traité, Synthèse 150
03/04/2020
Congé parental à temps partiel - Calcul de l’indemnité de licenciement
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, la période de congé parental à temps partiel doit être considérée comme du temps complet.
Cette solution paraît évidente, le congé parental intégral est déjà pris en compte pour moitié (article L1225-54 du Code du travail), elle a été confirmée par une réponse ministérielle du 24 mai 1999 (n°30420) et par un arrêt de la CJCE du 22 octobre 2009 qui a une valeur supra-légale.
Il aura néanmoins fallu un peu moins de deux ans à la Cour de cassation pour la confirmer.
En effet, par un arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle, cette dernière a confirmé sa position par un arrêt du 8 mai 2019.
C’est dans ces conditions que par un arrêt du 18 mars 2020 la chambre sociale a considéré que le montant de l’indemnité de licenciement doit être calculé entièrement sur la base de la rémunération à temps complet, de même que l’allocation de congé de reclassement.
Une question demeure, pourquoi avoir saisi la CJUE de cette question préjudicielle alors que la solution était évidente ?
Source : Soc. 18 mars 2020, pourvoi n° 16-27825, FP-PB
31/03/2020
Preuve des heures supplémentaires
Il résulte de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mars 2020 (n° 18-10.919, FP-P+B+R+I) et de la note explicative que la jurisprudence en matière de preuve sur les heures supplémentaires évolue.
Depuis un arrêt du 25 février 2004 (pourvoi n° 01-45.441, Bull. 2004, V, n° 62), la Cour de cassation juge que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Ces éléments doivent être suffisamment précis, on peut citer : des décomptes d’heures (Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.594 ; Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.490), des relevés de temps quotidiens (Soc., 19 juin 2013, n° 11.27-709), un tableau (Soc., 22 mars 2012, n° 11-14.466), ou encore des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.743).
Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré dans un arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18) que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
C’est pourquoi la chambre sociale fait évoluer sa jurisprudence, sans modifier l’ordre des étapes de la règle probatoire (lié à l’article 6 du CPC), elle a décidé d’abandonner la notion d’étaiement, pouvant être source de confusion avec celle de preuve, en y substituant l’expression de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande.
La Cour de cassation entend souligner que les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée.
C’est précisément pour avoir fait porter son analyse sur les seules pièces produites en l’espèce par le salarié, qui versait aux débats des décomptes d’heures qu’il prétendait avoir réalisées, aboutissant ainsi à faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires exclusivement sur celui-ci, que l’arrêt de la cour d’appel est censuré.
La chambre sociale marque ainsi sa volonté de contrôler le respect par les juges du fond du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires.
Source : Soc. 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP-P+B+R+I
Note explicative relative à l’arrêt n°373 du 18 mars 2020
18/03/2020
Inaptitude et reprise du paiement des salaires : la reprise d'un emploi est indifférente
L'employeur est tenu de verser les salaires du salarié inapte non reclassé et non licencié à l'expiration du délai d'1 mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ; peu importe que le salarié ait, ou non, retrouvé une activité professionnelle.
Pour condamner une salariée à rembourser à son employeur d'alors les salaires versés par celui-ci entre le 12 octobre 2014, soit 1 mois après sa déclaration d'inaptitude, et le 3 décembre suivant, date de son licenciement, une cour d’appel a retenu que, depuis le 17 septembre 2014, l'intéressée a retrouvé un nouvel emploi à temps plein.
Saisie, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs constatations que le contrat n'avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l'employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d’appel a violé l'article L. 1226-4 du Code du travail.
De l'arrêt des juges du droit il s'évince que l'employeur est tenu de verser les salaires du salarié inapte non reclassé et non licencié à l'expiration du délai d'1 mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ; le fait que le salarié ait retrouvé un emploi n'est pas une circonstance exonératoire.
Sources : Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-10.719, FS-P+B
Dépêches JurisClasseur - Actualités
JCl. Travail Traité, Synthèse 150
11/12/2019
Obligation de sécurité - Absence de harcèlement moral avéré
Dans un arrêt du 27 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui confirme l’arrêt inédit du 6 décembre 2017 (pourvoi n°16-10889).
Lorsqu’un salarié dénonce des faits de harcèlement moral, l’employeur a l’obligation de diligenter une enquête, à défaut il manque à son obligation de sécurité, et ce, même si les faits de harcèlement moral ne sont pas établis.
Cela signifie que si le salarié ne parvient pas à prouver l’existence d’un harcèlement moral mais que l’employeur n’a pas diligenté une enquête, non seulement le salarié pourra obtenir des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, mais aussi, éventuellement contester un licenciement si ce manquement en est la cause.
Sources : Soc. 27 novembre 2019, pourvoi n°18-10551, FP-PB
11/12/2019
Obligation de sécurité - Licenciement pour inaptitude - Accident du travail et maladie professionnelle
Dans son rapport annuel 2018, la Cour de cassation est revenue sur les arrêts n°646 et 649 du 3 mai 2018 et sa note explicative dont les éléments sont ci-dessous rappelés :
- Le conseil de prud’hommes est toujours compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux d’un licenciement pour inaptitude et il sera dépourvu de caractère réel et sérieux si l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, notamment au titre de son obligation de sécurité. Des dommages et intérêts sont alors alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Lorsqu’il n’a pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut solliciter auprès du conseil de prud’hommes des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et l’article L4121-1 du Code du travail, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité.
- Lorsque le salarié a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le conseil de prud’hommes demeurent donc compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement mais il n’est pas compétent pour statuer sur des dommages et intérêts fondés sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité.
- Lorsque le salarié a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, il formulera devant le pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement TASS) ses demandes de dommages et intérêts (faute inexcusable de l’employeur), étant précisé que la perte des droits à la retraite est déjà réparée par la rente (ou le capital) versée par la caisse.
Pour résumer, lorsque le salarié n’a pas été indemnisé au titre de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, toutes les demandes peuvent être formulées devant le conseil de prud’hommes. Lorsqu’il a été indemnisé à ce titre, deux juridictions sont compétentes, le conseil de prud’hommes uniquement pour la rupture du contrat de travail et ses conséquences immédiates, le pôle social du tribunal judiciaire pour indemniser l’accident du travail ou la maladie professionnelle, ainsi que le manquement de l’employeur à son obligation de résultat.
05/12/2019
Droit des affaires
Application du Code de la consommation à un professionnel démarché pour une insertion publicitaire
Un professionnel employant au plus 5 salariés, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par le Code de la consommation.
En l’espèce, le 1er septembre 2017, une femme, exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage, a reçu à son domicile le représentant d’une société et signé un ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local. Le 28 septembre 2017, elle a donné son accord par courriel au bon à tirer adressé par la société. La facture n’ayant pas été acquittée, la société l'a assigné en paiement. Bien que régulièrement convoquée, elle n’a pas comparu.
La société fait grief au jugement d'appliquer les règles du Code de la consommation (C. consommation, art. L. 221-3 s.), d’annuler l’ordre d’insertion et de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que le contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclu par un professionnel tel qu’un marchand de bois de chauffage à l’effet de promouvoir l’entreprise auprès du public, entre dans le champ d’activité principale de ce dernier. Dès lors, les exigences posées par les articles L. 221-3 et L. 221-5 du Code de la consommation ne peuvent être invoquées par le professionnel.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui juge que, s’il résulte de l’article L. 221-3 du Code de la consommation que le professionnel employant 5 salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, en l’espèce, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal d’instance a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale. Dès lors les dispositions protectrices du Code de la consommation trouvent à s’appliquer.
Sources : Dépêches JurisClasseur - Actualités
JCl. Concurrence Consommation, Synthèse 70
Cour de cassation 1ère chambre civile - 27 novembre 2019, n° 18-22.525, FS-P+B+I, Sté Memo. Com c/ X
10/10/2019
Jugé conforme, le barème « Macron » peut être écarté au cas par cas
Première cour d’appel à statuer sur le sujet, la cour de Reims juge le barème « Macron » conforme aux textes internationaux, mais admet la possibilité pour le juge de ne pas l’appliquer, sur demande du salarié, s’il n’assure pas à ce dernier une indemnisation adéquate.
Un nouvel épisode de la saga judiciaire sur le barème « Macron » vient de s’écrire avec le premier arrêt de cour d’appel en la matière, rendu par la cour d’appel de Reims le 25 septembre 2019.
Depuis maintenant un an, on ne compte plus le nombre de conseils de prud’hommes ayant décidé d'écarter l’application du barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail, au motif qu'il méconnaîtrait, notamment, les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention 158 de l'OIT reconnaissant aux travailleurs licenciés sans motifs valables le droit à une indemnité adéquate et appropriée.
L’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 concluant à la compatibilité du barème avec l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT n’a pas mis fin à cette fronde, certains juges du premier degré refusant de s’aligner sur cette position. C’est pourquoi le premier arrêt de cour d’appel était très attendu. La solution retenue, à propos de l’affaire ayant donné lieu au jugement du conseil de prud’hommes de Troyes est plutôt nuancée.
Pour rappel, d'après le barème, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un minimum et un maximum variant en fonction de l'ancienneté du salarié, avec un maximum de 20 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 30 ans d'ancienneté.
La cour d’appel de Reims se prononce sur la conventionnalité du barème au regard des articles 10 de la Convention 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne qui, relève-t-elle, sont rédigés de façon très proche. Elle estime en effet que ces deux textes sont dotés d’un effet direct horizontal, permettant ainsi à tout salarié le droit de s’en prévaloir devant les juridictions nationales dans un litige l’opposant à son employeur.
Pour la cour d’appel, cet effet direct, « dont l’absence ne peut se déduire de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l’obligation qu’elles imposent », résulte du caractère suffisamment précis de l’engagement défini par ces normes internationales et du fait que le droit qui y est reconnu au profit des particuliers peut être assuré sans nécessiter l’intervention d’une législation nationale d’application.
A noter : S'agissant de la portée de l'article 24 de la Charte sociale européenne, la Cour de cassation a adopté la position contraire dans son avis du 17 juillet 2019, celle-ci n'ayant reconnu un effet direct qu'à l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT.
On relèvera que la cour d'appel, si elle fait mention de cet avis au début de son arrêt, n'y fait curieusement plus référence par la suite et procède à sa propre analyse.
Ajoutons que, comme la Cour de cassation, la cour d’appel juge non fondé le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales reconnaissant le droit à un procès équitable, dans la mesure où le salarié conserve « la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l’office de ce dernier, laisse intacte la nature de son pouvoir ».
Analysant les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, le juge rémois conclut à leur conformité aux textes précités. Son raisonnement s’articule en 3 temps.
Tout d’abord, il considère qu’une indemnité adéquate ou appropriée n’implique pas une réparation intégrale du préjudice mais suppose une indemnisation d’un montant raisonnable en lien avec ce préjudice et suffisant pour assurer l’effectivité de l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas incompatible en soi avec l’instauration d’un plafond.
Elle relève ensuite que le dispositif prévu par le Code du travail est de nature à porter atteinte au droit à une indemnisation adéquate et appropriée. Ainsi, notamment, les plafonds d’indemnisation sont faibles pour les salariés ayant peu d’ancienneté, ils cessent d’évoluer à compter de 29 ans d’ancienneté, enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’homal ne dispose pas de toute latitude pour individualiser le préjudice de perte d’emploi et sanctionner l’employeur, l’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable avec d’autres indemnités mais dans la limite des plafonds prévus par le barème. Néanmoins, ces atteintes au droit à une indemnisation appropriée lui paraissent légitimes et proportionnées. Légitimes dans la mesure où les dispositions en cause, prises par ordonnance et ratifiées par le Parlement, ont une base légale et démocratique. Proportionnées car, notamment, l’indemnisation reste soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond dans les limites des fourchettes prévues au barème, l’amplitude des minima et maxima ne saurait, en raison de sa progression réelle, être considérée comme incitant, en elle-même, au licenciement, le barème ne s’applique pas en cas de licenciement nul.
Dès lors, pour la cour d’appel de Reims, « le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure (…) à la conventionnalité de celui-ci ».
La cour d’appel refuse de se référer à la décision du comité européen des droits sociaux (CEDS) du 8 septembre 2016 qui a condamné, au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne, un plafond d’indemnisation des licenciements injustifiés de 24 mois de salaire mis en place par la Finlande. Elle estime qu’elle ne peut pas transposer au présent litige, et tenir pour acquise et certaine, l’interprétation de ce texte dans une affaire ne concernant pas la France, et alors que le CEDS devrait se prononcer prochainement sur la compatibilité du barème français avec ledit article 24.
Le fait que le barème soit reconnu conforme aux articles 10 de la Convention 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne ne signifie pas qu’il doive être respecté dans tous les cas.
Pour la cour d’appel de Reims, il existe en effet deux types de contrôle de conventionnalité d’une règle de droit interne au regard des normes européennes et internationales : le contrôle de conventionnalité de la règle de droit elle-même (contrôle « in abstracto ») et celui de son application dans les circonstances de l’espèce (contrôle « in concreto »). Elle juge ainsi que « le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné ». Ainsi, il s’agit pour le juge de déterminer, dans chaque cas d’espèce, si le barème peut être appliqué ou doit être écarté dans le cas où son application porterait atteinte au droit à une réparation adéquate. La recherche de proportionnalité doit se faire « in concreto ».
La cour pose toutefois une condition à cette recherche : elle ne peut être exercée que si le salarié le demande expressément au juge, « elle ne saurait être exercée d’office par le juge du fond qui ne peut, de sa seule initiative, procéder à une recherche visant à écarter, le cas échéant, un dispositif dont il reconnaît le caractère conventionnel ».
Mais, il est par ailleurs précisé que le salarié n’a pas besoin « de justifier au préalable d’un préjudice de perte d’emploi supérieur au plafond d’indemnisation correspondant à son ancienneté ou qu’il démontre avoir subi un tel préjudice qui ne serait pas réparé de façon adéquate ou appropriée ».
En l’espèce, le salarié n’ayant pas demandé au juge un contrôle concret de son cas particulier mais seulement un contrôle abstrait de conventionnalité du barème, le juge rémois applique celui-ci.
A noter : Le juge rémois a donc choisi d’appliquer deux types de contrôle, option que paraît déjà avoir prise le conseil de prud’hommes de Grenoble moins d’une semaine après l’avis de la Cour de cassation (Cons. prud'h. Grenoble 22-7-2019 n° 18/00267). Cette position sera-t-elle avalisée par la Cour de cassation ? Le débat n’est pas clos.
Sources : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003 SCP BTSG / X
17/07/2019
Droit du travail
Barème « Macron » sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (abusif)
Dans un avis très attendu rendu ce jour, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que les barèmes prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail qui limitent l’indemnisation du préjudice subi par le salarié licencié abusivement sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
En pratique, cet avis va mettre fin à la jurisprudence fluctuante (mais majoritairement contre les barèmes) des juges du fond.
En droit et en équité, cette position est très contestable puisque le droit à être indemnisé de son entier préjudice est tout simplement évincé !
Seule une décision différente des juridictions européennes pourrait permettre de revenir sur cet avis.
Source :
Avis n° 15013 du 17 juillet 2019 - Formation plénière pour avis
12/07/2019
Droit du travail
Caractère brut ou net des condamnations prud’homales en l’absence de précision
Dans un arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation poursuit sa clarification et simplification entamée en 2016 et 2018 (arrêts inédits) dans un arrêt de principe (P+B).
En effet, dans cet arrêt, la plus haute juridiction civile a considéré que lorsque la décision ne s’est pas « prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales », l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée. Ce qui signifie qu’à défaut de précision, les condamnations prononcées sont brutes.
Cette question étant désormais définitivement tranchée, les justiciables qu’ils soient employeurs ou salariés ne seront désormais plus dans l’incertitude.
Source : Soc. 03 juillet 2019, pourvoi n°18-12.149, FS-P+B
05/07/2019
Droit du travail
Harcèlement moral invocable pendant une dispense d’activité
Les dispositions relatives au harcèlement moral sont applicables pendant toute la durée de la relation salariale, peu important que le salarié soit dispensé d’activité.
Après avoir été mis à la retraite le 1er octobre 2012, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Avant cela il a bénéficié, à compter du 31 décembre 2006, d'un congé de fin de carrière avec cessation d'activité. Et l’intéressé a exercé divers mandats représentatifs à compter de 2009.
En appel sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral a été jugée irrecevable, les juges retenant qu’elle était prescrite s'agissant des faits remontant avant le 9 juillet 2009. Surtout, pour la cour d’appel, le salarié, en congé de fin de carrière sans activité depuis le 31 décembre 2006, ne pouvait invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu'il n'était plus sur son poste de travail au sein de l'entreprise. Dit autrement, n’exerçant plus aucun travail dans la société, les agissements allégués n'ont pas pu avoir pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail.
La Cour de cassation n’a pas souscrit à ce raisonnement, mettant en avant, au contraire, que le salarié était demeuré lié à l'entreprise par un contrat de travail jusqu'à son départ en retraite le 1er octobre 2012. Les juges du fond auraient dû rechercher, comme il leur était demandé, si les agissements dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral, certains étant postérieurs à son départ en congé de fin de carrière, tels que : le refus de fournir des outils nécessaires à son activité syndicale en le privant pendant deux ans d'un accès à l'intranet de l'entreprise ; le refus de lui permettre d'assister aux réunions de délégués du personnel par télé-présence après la reconnaissance de son état de travailleur handicapé ; des erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire ainsi que des erreurs quant au calcul de l'intéressement et de la participation. Selon la Cour, il s’agissait là de faits qui permettent de présumer un harcèlement moral entre le 9 juillet 2009 et le 1er octobre 2012. En refusant d’en tenir compte, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du Code du travail selon lequel « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’arrêt rendu mérite attention en ce qu’il décide, pour la première fois à notre connaissance, que ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période.
Sources : Dépêches JurisClasseur - Actualités
JCl. Travail Traité, Synthèse 100
Soc. 26 juin 2019, pourvoi n°17-28.328, FS-P+B
04/04/2019
Rupture du contrat de travail : la prise d’acte n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable de l’employeur
L'article 1226 du Code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation en a décidé ainsi, apportant cette réponse dans le cadre d’une demande d’avis dont elle avait été saisie par un conseil de prud’hommes.
Dans l’affaire soumise à la juridiction prud’homale, le salarié, qui avait signé un CDD avec l’employeur, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandait à la justice de faire produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement. L’employeur entendait lui voir produire les effets d’une démission. La question soumise à la Cour de cassation avait toutefois été formulée en termes généraux, c’est-à-dire sans faire référence à l’existence en l’espèce d’un CDD, centrant le débat sur la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
La chambre sociale, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224, 1225 et 1226 du Code civil relatives à la résolution du contrat, constate que les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du Code civil ne leur sont pas applicables. En conséquence, elle répond par la négative à la demande d’avis qui lui a été présentée : cet article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Sources : Dépêches JurisClasseur - Actualités
JCl. Travail Traité, Synthèse 150
Soc. 3 avril 2019, avis n° 15003
01/02/2019
Rupture conventionnelle et harcèlement moral
L’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation considère que le harcèlement moral ne constitue pas de facto un vice du consentement justifiant de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
Cette décision est surprenante d’un point de vue juridique à deux égards, d’une part, le harcèlement moral n’affecte-t-il pas nécessairement le consentement et ne constitue-t-il pas une violence au sens de l’article 1130 du Code civil, d’autre part et surtout, l’article L1152-3 du Code du travail ne dispose-t-il pas que toute rupture du contrat de travail intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul ?
Sources :
Soc. 23 janvier 2019, pourvoi n°17-21.550, P+B
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2019_9139/janvier_9140/92_23_41202.html
03/12/2018
Copropriété - Responsabilité du président du conseil syndical
Le président ne peut être responsable qu’en cas de faute suffisamment grave.
Une simple négligence dans la surveillance des comptes ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du président du conseil syndical.
Un copropriétaire, reprochant diverses fautes commises par le président du conseil syndical dans l’exercice de son mandat, et notamment dans la surveillance des comptes, l’assigne en responsabilité.
La cour d’appel rejette la demande.
Le pourvoi formé contre cette décision est rejeté : l’action en responsabilité délictuelle d’un tiers à l’encontre d’un membre du conseil syndical, mandataire du syndicat des copropriétaires, et fondée sur un manquement contractuel, s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du Code civil. Une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l'absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité de ces derniers.
A noter : La précision est nouvelle.
Dans tout syndicat des copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 21). Le conseil syndical contrôle la comptabilité du syndicat (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 26). Le conseil syndical n’ayant pas la personnalité morale, sa responsabilité en tant que groupement ne peut être recherchée. En revanche, chacun de ses membres peut engager sa responsabilité par sa faute. Cette responsabilité est de nature contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires dont les membres du conseil syndical sont les mandataires. Elle est fondée sur les dispositions de l’article 1992 du Code civil relatif à la responsabilité des mandataires, dont l’alinéa 2 dispose que « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ». Leur faute sera donc appréciée avec une certaine bienveillance compte tenu du caractère gratuit de leur mandat.
Mais qu’en est-il lorsque l’action en responsabilité est exercée par le syndic ou les copropriétaires, ou même un tiers à la copropriété ? Ce sont les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle qui ont alors vocation à s’appliquer. Mais, précise la Cour de cassation en l’espèce, l'action s'exerce néanmoins dans les limites prévues par l'article 1992 du Code civil précité. Il en résulte que même à l’égard des tiers, leur responsabilité ne pourra être recherchée qu’en cas de faute suffisamment grave. La cour d’appel a donc pu retenir que tel n’était pas le cas pour une négligence dans la surveillance des comptes.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Sources :
Civ III - 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-27766 - FS-P+B+I
La Quotidienne - Editions Francis Lefebvre du 03/12/2018
09/11/2018
Droit de la construction - assurance
Le constructeur qui n’a pas déclaré l’activité de constructeur de maison individuelle n’est pas garanti en assurance responsabilité civile décennale lorsqu’il conclut un contrat de construction de maison individuelle
Dans un arrêt du 18 octobre 2018 dont la publication est large (PBRI), la Cour de cassation a considéré que le contrat d’assurance garantissant l’entrepreneur contre des désordres de nature décennale sur les travaux de techniques courantes (gros œuvre, plâtrerie, cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie, installation sanitaire, menuiserie, PVC) ne valait pas pour un contrat de construction de maison individuelle si cette activité n’a pas été déclarée à l’assureur.
Cette décision est extrêmement sévère pour l’entrepreneur qui n’est pas garanti, pour le dirigeant qui engage sa responsabilité pénale et civile, ainsi que pour le maître de l’ouvrage qui ne sera probablement pas indemnisé.
S’il a souscrit un crédit immobilier, le maître de l’ouvrage pourra éventuellement rechercher la responsabilité de la banque (qui a l’obligation de vérifier l’assurance de l’entrepreneur) mais, en tout état de cause, il s’agit bien d’une décision contraire à l’intérêt des consommateurs et des entrepreneurs !
Sources :
Civ III - 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-23741 - FS-P+B+R+I
La Quotidienne - Editions Francis Lefebvre du 09/11/2018
23/07/2018
Filiation
Examen comparé des sangs - compétence du juge des référés - revirement
La Cour de cassation juge depuis 1994 que l’examen comparé des sangs peut être sollicité devant le juge des référés avant tout procès au fond.
Cependant, l’article 16-11 du Code civil, excluait cette possibilité pour l’expertise génétique, elle ne pouvait être ordonnée que par les juges du fond.
Par souci de parallélisme, la Cour de cassation a donc décidé d’opérer un revirement de jurisprudence, l’examen comparé des sangs ne sera désormais possible qu’après avoir été ordonnée dans une instance au fond.
Si un tel positionnement paraît logique, il ne sera pas de nature à désencombrer les tribunaux. En effet, désormais en matière de filiation il faudra obligatoirement saisir le tribunal de grande instance d’une procédure longue (2 à 6 ans en fonction des juridictions) et couteuse alors qu’une action en référé permettait, lorsque le demandeur se rendait compte qu’il avait tort après expertise, d’éteindre rapidement le contentieux.
Sources :
Civ I - 12 juin 2018, pourvoi n° 17-16793 - FS-P+B+R+I
5/07/2018
Droit pénal du travail
L’utilisation par des salariés de leur temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils perçoivent une rémunération de leur employeur constitue le délit d’abus de confiance.
Le salarié qui utilise son temps de travail à d'autres occupations que l'exécution de ses fonctions commet non seulement une faute disciplinaire susceptible de justifier un licenciement (Soc. 4 juin 1997, pourvoi n°94-43568 - Soc. 18 mars 2009, pourvoi n° 07-44247), mais également, le cas échéant, un délit.
Dans un arrêt de 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, pour la première fois, jugé que l'utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur, constitue un abus de confiance, engageant la responsabilité pénale du salarié (Crim. 19 juin 2013, pourvoi n°12-83031, publié FS-PBR).
L'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la chambre criminelle en constitue la confirmation.
En l'espèce, deux salariés ont été reconnus coupables du délit d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance pour avoir, sur le temps, dans les locaux et avec les moyens et salaires fournis par leur employeur, exercé des activités, démarches et transactions non justifiées par l'intérêt de leur employeur, à qui elles ont été dissimulées.
Sources :
Crim. 3 mai 2018, pourvoi n°16-86369
La Quotidienne - Editions Francis Lefebvre du 05/07/2018
06/06/2018
Droit de la famille - divorce
Demande de prestation compensatoire en appel
En vertu de l’article 564 du Code de procédure civile, les demandes nouvelles formulées devant la cour d’appel sont irrecevables.
De manière assez surprenante, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 14 mars 2018 que la prestation compensatoire sollicitée pour la première fois devant la cour d’appel n’était pas irrecevable car elle constituerait un accessoire à la demande en divorce.
Concrètement cela signifie que si vous avez oublié de solliciter une prestation compensatoire devant le juge aux affaires familiales ou, surtout, si les revenus ont changé depuis le jugement et que leurs différences justifieraient en appel une prestation compensatoire, vous pouvez formulé cette demande pour la première fois devant la Cour d’appel. Les contentieux devant les chambres de la famille risquent de durer encore plus longtemps…
Sources :
Civ I - 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14874 - P+B
27/02/2018
Droit du travail
Le licenciement pour inaptitude physique d’une salariée reprenant le travail à l’issue du congé de maternité est possible mais, pour être valable, il doit être motivé conformément aux exigences du Code du travail et faire état de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité.
La Cour de cassation confirme une décision récente, ayant admis la possibilité pour l’employeur de licencier une salariée enceinte ou reprenant le travail après un congé de maternité en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de la reclasser (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-15.333 FP-PB). Un tel motif est conforme à l’article L 1225-4 du Code du travail qui autorise le licenciement de la salariée en cas d’impossibilité de maintenir son contrat de travail. Mais la Haute Cour exige que la lettre de licenciement fasse expressément état de cette impossibilité. A défaut, le licenciement insuffisamment motivé est nul.
A noter : le motif de rupture, tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement, fixe en effet le cadre juridique de la rupture. Il doit donc permettre à la salariée - et au juge en cas de litige - de vérifier que la protection liée à sa grossesse ou à sa maternité a bien été prise en compte.
On peut penser que c’est précisément pour limiter ce type de contentieux que l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et son décret d’application 2017-1702 du 15 décembre 2017 ont accordé à l’employeur la possibilité de préciser les motifs du licenciement après sa notification. Depuis le 18 décembre 2017, date d’entrée en vigueur du dispositif, une telle précision peut en effet être apportée dans les 15 jours suivant la notification de la rupture, sur demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur (voir La Quotidienne du 12 janvier 2018 et du 30 janvier 2018).
Les conséquences de cette possibilité de précision du motif, telles que prévues par l’article L 1235-2 du Code du travail désormais en vigueur, sont de deux ordres. D’une part, c’est la lettre de licenciement ainsi précisée qui fixe les limites du litige. Dans une situation comme celle ayant donné lieu à l’arrêt ci-dessus, si l’employeur avait précisé, dans le délai de 15 jours, que le licenciement de la salariée était justifié par une inaptitude physique rendant impossible le maintien de son contrat de travail, les juges en auraient tenu compte pour apprécier la légitimité de la rupture : le licenciement n’aurait pas pu être jugé nul au seul vu de la lettre de licenciement. D’autre part, si le salarié ne demande pas à l'employeur des précisions sur le motif de licenciement, l’insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse : ce vice de forme est réparé par une indemnité d’un mois de salaire maximum.
Mais une question reste posée : la Cour de cassation transposera-t-elle ce principe au cas où la sanction de l’insuffisance de motivation est non pas l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, mais sa nullité, comme c’était le cas en l’espèce ? On attendra avec intérêt que la Haute Cour se prononce sur ce point.
Sources :
Soc. 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-23190
La Quotidienne - Editions Francis Lefebvre du 27/02/2018
16/02/2018
Droit du travail
L’employeur ne peut pas consulter le compte Facebook du salarié
L'employeur porte une atteinte déloyale et disproportionnée à la vie privée du salarié en accédant au contenu du compte Facebook de celui-ci sans y être autorisé, au moyen du téléphone portable professionnel d'un autre salarié.
Pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce dans le cadre d’un litige relatif à l’accès par l’employeur à des informations diffusées par un salarié sur un réseau social, en l’espèce un compte Facebook. Bien que rendu en formation restreinte et non publié, l'arrêt mérite l'attention.
L’employeur, à la recherche d’éléments de preuve pour se défendre dans le cadre d’un procès prud’homal, avait, par constat d’huissier, extrait des informations du compte Facebook du salarié partie au litige, à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié autorisé à consulter les publications de ce compte. Les juges du fond ont déclaré ces éléments irrecevables en raison de l’atteinte portée à la vie privée du salarié.
L’employeur, au soutien de son pourvoi, faisait valoir notamment que l’utilisation du téléphone portable professionnel étant présumée professionnelle, l’employeur pouvait légitimement consulter les informations contenues dans celui-ci et les utiliser pour assurer sa défense dans le cadre du litige prud’homal l’opposant au salarié.
La Cour de cassation rejette cet argument. En effet, l'accès aux informations litigieuses était réservé aux personnes autorisées, ce que n’était pas l’employeur. La cour d’appel a donc pu en déduire que ce dernier ne pouvait pas y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié, peu important qu’elles aient été obtenues par constat d’huissier à partir d’un téléphone portable professionnel.
A noter : l’arrêt ne précise pas le degré de paramétrage de confidentialité du compte, à savoir si les publications étaient accessibles seulement aux « Amis », ou « Amis et leurs amis ». Tout au plus peut-on supposer qu’elles n’étaient pas accessibles à tout le monde. La chambre sociale paraît toutefois s’accorder avec la position de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendue à propos de la qualification d’injures publiques, admettant que le profil Facebook constitue un espace privé s’il est paramétré pour n’être accessible qu’à un nombre très restreint de personnes (Cass. 1e civ. 10-4-2013 n° 11-19.530 FS-PBI).
Par ailleurs, la lecture de l'arrêt ne permet pas de savoir si les informations avaient été recueillies par l'employeur, avec ou sans la participation ou l’accord du salarié attributaire du téléphone portable professionnel, autorisé quant à lui à consulter les informations du compte. A cet égard, notons qu’une cour d’appel a considéré que l'employeur ne peut pas être considéré comme ayant eu accès à une information de manière déloyale si les captures d'écran du compte Facebook d’un salarié, dont il se prévaut pour établir des faits fautifs, ont été réalisées par une personne habilitée à consulter ce compte et qui en a informé librement et spontanément l'employeur (CA Rouen 26-4-2016 n° 14/03517).
Sources :
Soc. 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19609
La Quotidienne - Editions Francis Lefebvre du 15/02/2018
30/01/2018
Droit du travail
Clause de non-concurrence : pas de minoration de la contrepartie financière en fonction des circonstances de la rupture
Le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, le salarié qui a opté pour la rupture conventionnelle de son contrat bénéficie de la contrepartie prévue par la convention collective applicable à la relation de travail, peu important que celle-ci n’envisage que les hypothèses de licenciement et de démission.
Une salariée fait grief à des juges du fond d’avoir décidé qu’elle ne pouvait bénéficier des dispositions conventionnelles relatives à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence - dénommée clause de respect de la clientèle - prévue dans son contrat de travail au motif que ces dispositions n'envisagent que les hypothèses de licenciement et de démission, et non de rupture conventionnelle pour laquelle elle a opté. Considérant donc que l’intéressée n’avait pas droit à la contrepartie financière prévue par la convention collective applicable à la relation de travail, ils ont réduit la somme allouée à cette dernière au titre de cette clause, illicite en l’occurrence, à 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre, contre 39 000 € sollicités.
Mais pour la Cour de cassation, saisie par la salarié, le compte n’y est pas : la cour d’appel ne pouvait statuer ainsi dès lors que « le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne [peut] être minoré en fonction des circonstances de la rupture » (Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 10-11.590 : JurisData n° 2012-000811 ; JCP S 2012, 1208, note I. Beyneix. – Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-25.847 : JurisData n° 2015-007518 ; JCP S 2015, 1276, note I. Beyneix. - Cass. soc., 14 avr. 2016, n° 14-29.679 : JurisData n° 2016-007002 ; JCP S 2016, 1229, note I. Beyneix). La contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était donc applicable en l’espèce.
Procédé condamnable, comme le rappelle le juge du droit, le fait de minorer le montant de la contrepartie pécuniaire selon les modes de rupture ne rend pas pour autant nulle la clause de non-concurrence, laquelle doit être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie pour une circonstance ou un mode de rupture déterminée. C'est le montant le plus élevé de la contrepartie financière, parmi ceux qui étaient prévus pour les différents modes de rupture, qui doit alors être accordé au salarié. Ce que confirme, là encore, la cour.
Sources :
Soc., 18 janv. 2018, n° 15-24.002, FS-P+B
Dépêches JurisClasseur - Actualités
25/01/2018
Droit du travail
Prise d’acte de rupture du salarié maintenu dans l’ignorance de ses futures missions
L’employeur qui, dans une période de changements dans l’entreprise, laisse le salarié dans l’expectative sur la nature de ses missions et n'apporte aucune réponse concrète à ses demandes manque gravement à ses obligations. Le salarié est fondé à prendre acte de la rupture.
Dans cette affaire, un salarié occupant un poste d'acheteur est informé que son entreprise est engagée dans un processus de réorganisation. L'agence pour laquelle il travaille doit être supprimée et son activité doit être transférée vers un autre site. Début janvier, il sollicite l'employeur par courriel afin d'obtenir des précisions sur sa future activité : son poste d'acheteur est en effet supprimé et il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exercer son métier du fait de l'interdiction de passer des achats directs et de la non-mise à disposition de l'outil informatique nécessaire. L'employeur se contente de lui répondre que "une fois le déménagement terminé, l'informatique sera opérationnelle et une réunion sera organisée dès que possible pour déterminer la stratégie". Fin janvier, le salarié réitère sa demande, qui reste sans réponse. Il prend acte de la rupture de son contrat de travail début février, reprochant principalement à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de lui fournir le travail convenu et de l'avoir laissé dans l'expectative sur la nature et le périmètre de ses missions futures.
Pour la cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, le fait pour un employeur, dans un période de réorganisation, de laisser un salarié, malgré ses demandes, dans l’ignorance de ses futures missions est une faute suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. La rupture produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A noter : cette solution peut être rapprochée d’une décision plus ancienne aux termes de laquelle la Haute Juridiction a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, aux motifs qu’il n’avait pas informé le salarié d’un changement de fonctions et l’avait laissé durablement dans une situation d’incertitude professionnelle (Cass. soc. 7-7-2010 n° 08-45.537 F-D).
Sources :
Soc. 6 décembre 2017, pourvoi n°16-22019
La Quotidienne - Editions Francis Lefebvre du 25/01/2018
4/12/2017
Droit du travail
Port du foulard - Entreprise privée
Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, X... et ADDH, C-188/15), a dit pour droit : « L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».
Par arrêt du même jour (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15), la Cour de justice a dit pour droit : « L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.
En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».
La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette dernière décision, s’agissant du refus d’une salariée de renoncer au port du foulard islamique dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès de clients de l’employeur, qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.
Il en résulte que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l’article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients ; qu’en présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.
Source : Soc. 22 novembre 2017, n°13-19855, PBRI, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html
1/12/2017
Droit du travail
Calcul de l’indemnité de licenciement du salarié inapte
Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article L1226-4 alinéa 3 du Code du travail, le salarié licencié pour inaptitude, s’il n’effectue pas son préavis et si son contrat est rompu à la date de notification du licenciement, doit recevoir une indemnité de licenciement dont le calcul tient compte de l’ancienneté augmentée du préavis (en général 2 mois) comme s’il avait été effectué.
18/09/2017
Droit du travail
Dommages et intérêts pour licenciement abusif
Procédure orale
Dans un arrêt du 13 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes :
- L’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
- Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
- En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats. Dès lors qu’elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n’était ni présente ni représentée à l’audience, la cour d’appel ne pouvait que constater qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement.
Source : Soc. 13 septembre 2017, n°16-13578, PBRI
24/07/2017
Droit du travail
Licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Lorsqu’une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant le Conseil de prud’hommes la nullité du licenciement pour harcèlement moral et/ou manquement à l’obligation de sécurité et demande des dommages et intérêts.
En l’espèce, la salariée avait subi pendant de nombreuses années des changements de secrétaires de plus en plus fréquents, ayant entraîné une désorganisation de son service avec de très nombreux dysfonctionnements et un accroissement de sa charge de travail, ayant des répercussions sur sa santé mentale.
Source : Soc. 29 juin 2017, n° 15-15775, PB
29/05/2017
Droit du travail
Calcul indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d’une somme à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, retient qu’en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’il aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu pour cause de maladie.
Source : Soc. 23 mai 2017, n°15-22223, PBRI
29/05/2017
Droit du travail
Harcèlement sexuel
Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel.
En l’espèce, le président de l'association employeur avait « conseillé » à la salariée qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien ».
Les obligations découlant des articles L1153-1 (prohibition du harcèlement sexuel) et L1153-5 (obligation de sécurité de l’employeur) du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Sources : Soc. 17 mai 2017, n°15-19300
2/05/2017
Droit du travail
Sanction disciplinaire
L’employeur employant habituellement au moins vingt salariés ne peut pas prononcer une sanction disciplinaire autre que le licenciement (un avertissement en l’espèce) contre un salarié si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail.
Sources : Soc. 23 mars 2017, n°15-23090
7/04/2017
Droit du travail
Claude de mobilité exécutée de mauvaise foi par l’employeur
l'employeur qui ne justifie pas d'une réorganisation du site, qui a mis en œuvre de la clause de mobilité prévue par le contrat de travail en dehors de ce site, qui a par ailleurs notifié sa mutation au salarié sans lui laisser un délai suffisant alors même que ses carences dans la maîtrise du français ne lui permettaient pas de comprendre cette décision, n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sources : Soc. 29 mars 2017, n° 15-23822
7/04/2017
Droit de la sécurité sociale
Demande de reconnaissance de maladie professionnelle et délai d’instruction
Le délai de trois mois pour instruire les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle prévu par l’article R441-10 du Code de la sécurité sociale, est interrompu et repart intégralement après réception du certificat médical complémentaire sollicité par la caisse et une nouvelle fois après notification par la caisse de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire.
Sources : Civ II - 30 mars 2017, n° 16-13277
3/03/2017
Nouveaux délais de prescription pour les infractions pénales
Doublement des délais pour les crimes et les délits et création d'un délai butoir pour les infractions occultes : le régime de la prescription pénale est profondément réformé.
La mesure phare de la réforme opérée par la loi du 27 février 2017 allonge les délais de prescription de l'action publique (CPP art. 7 s.). Désormais, le délai est de 6 ans pour les délits, contre 3 ans jusqu'alors. Quant aux crimes, le délai de prescription de l'action publique passe de 10 à 20 ans. A noter que pour les contraventions, rien ne change : le délai de prescription reste fixé à 1 an. En principe, ces délais courent du jour où l'infraction est commise.
Comme auparavant, ces règles sont aménagées pour certains délits, en raison de leur gravité ou de la minorité de la victime. Un régime spécifique est prévu pour les infractions occultes ou dissimulées. Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation, le législateur précise que pour ces infractions, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où elles ont été découvertes. Mais il ajoute une nouveauté : un délai butoir au-delà duquel l'infraction sera de toute façon prescrite et qui démarre dès que l'infraction est commise. Ce délai est de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes. Plusieurs délits économiques et financiers sont concernés, notamment l'abus de biens sociaux et la tromperie.
Ces règles sont applicables immédiatement, y compris pour les infractions commises avant le 1ermars. Toutefois, la réforme ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique.
1/02/2017
Droit du travail
Un syndicat de copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L 1233-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions relatives aux licenciements pour motif économique.
Le syndicat de copropriétaire n’a pas à justifier d’une tentative de reclassement ni du motif économique du licenciement.
Sources : Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-26853, FS-PB
29/11/2016
Droit du travail
Publication du barème indicatif des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La loi Macron du 6 août 2015 prévoit la possibilité pour le juge prud'homal de prendre en compte un référentiel indicatif lui permettant de déterminer le montant des dommages et intérêts à accorder au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce référentiel est publié.
Ce barème indicatif détermine le montant de l'indemnité pour licenciement abusif susceptible d'être alloué au salarié en fonction notamment de son ancienneté, de son âge et de sa situation par rapport à l'emploi.
Ce montant vient en plus des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dues par ailleurs (par exemple indemnités de licenciement et de préavis, indemnité compensatrice de non-concurrence). L'application de ce référentiel est facultative pour le juge, à moins que le salarié et l'employeur ne la demandent conjointement.
|
ANCIENNETÉ
(en années complètes)
|
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
|
ANCIENNETÉ
(en années complètes)
|
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
|
|
0
|
1
|
22
|
14,5
|
|
1
|
2
|
23
|
15
|
|
2
|
3
|
24
|
15,5
|
|
3
|
4
|
25
|
16
|
|
4
|
5
|
26
|
16,5
|
|
5
|
6
|
27
|
17
|
|
6
|
6,5
|
28
|
17,5
|
|
7
|
7
|
29
|
18
|
|
8
|
7,5
|
30
|
18,25
|
|
9
|
8
|
31
|
18,5
|
|
10
|
8,5
|
32
|
18,75
|
|
11
|
9
|
33
|
19
|
|
12
|
9,5
|
34
|
19,25
|
|
13
|
10
|
35
|
19,5
|
|
14
|
10,5
|
36
|
19,75
|
|
15
|
11
|
37
|
20
|
|
16
|
11,5
|
38
|
20,25
|
|
17
|
12
|
39
|
20,5
|
|
18
|
12,5
|
40
|
20,75
|
|
19
|
13
|
41
|
21
|
|
20
|
13,5
|
42
|
21,25
|
|
21
|
14
|
43 et au-delà
|
21,5
|
Deux cas de majoration des indemnités, les montants indiqués dans le référentiel sont majorés d'un mois de salaire dans les deux cas suivants :
- lorsque le salarié était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture ;
- en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du salarié tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.
18/11/2016
Droit du travail
Licenciement pour motif économique : clarification de la Cour de cassation sur le périmètre du groupe
Dans trois arrêts du 16 novembre 2016 diffusés et mis en ligne sur le site de la Cour de cassation le même jour, accompagnés chacun d’une note explicative, la haute juridiction clarifie la notion de groupe dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique en distinguant le périmètre du groupe pour l’appréciation du motif économique du licenciement de celui du groupe dans lequel doivent être recherchées les possibilités de reclassement par l’employeur. Elle précise également l’appréciation de la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
1) Groupe et appréciation du motif économique. - Après avoir rappelé que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, la Cour de cassation pose comme principe que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du Code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Comme elle le précise dans son communiqué, la chambre sociale décide ainsi de se référer au groupe tel qu’appréhendé par l’article L. 2331-1 du Code du travail relatif au comité de groupe, dont les attributions sont notamment de recevoir les informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent ainsi que la communication des comptes et du bilan consolidés. Cet article emploie la notion d’entreprise dominante, plus large que celle de « société mère », et vise pour déterminer un ensemble économique, d’une part les entreprises contrôlées, ce qui renvoie à des rapports de nature sociétaire du Code de commerce et, d’autre part des entreprises sous influence dominante, ce qui renvoie à des éléments sociétaires et économiques.
Dans le premier arrêt (n° 14-30.063), la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que le « Mouvement Leclerc », groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d’une association des centres distributeurs Leclerc qui, notamment, décide de l’attribution de l’enseigne Leclerc à ses adhérents et définit les orientations globales du mouvement, d’un groupement d’achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent surtout des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, n’est pas un groupe au sens économique du terme. Dès lors la cause économique du licenciement contesté en l’espèce devait donc uniquement s’apprécier au niveau de l’entreprise adhérente.
2) Sur le périmètre du groupe de reclassement et la charge de la preuve. - La Cour de cassation confirme la règle selon laquelle la recherche des possibilités de reclassement que l’employeur est tenu d’effectuer, doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le critère reste donc la possible permutation de tout ou partie du personnel mais se posait la question de la charge de la preuve de ce périmètre. Dans son communiqué, la Cour de cassation précise qu’il appartient au juge du fond de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Elle juge ainsi que ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d’appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l’employeur que par le salarié, a constaté dans une première espèce (n° 14-30.063) qu’il n’était pas démontré que l’organisation du réseau de distribution (« mouvement Leclerc ») auquel appartenait l’entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel ou au contraire dans une seconde espèce (n° 15-19.927 à 15-19.939) qu’il était démontré que le périmètre du groupe de reclassement était limité à une société holding et trois filiales.
3) Sur l’appréciation la pertinence d’un PSE. - La cour rappelle que la pertinence doit être appréciée (notamment par la DIRECCTE qui procède, en cas de demande d’homologation, à un contrôle de proportionnalité du PSE) en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement.
Dans la lignée de des deux autres arrêts du même jour, la Cour de cassation procède alors dans un troisième arrêt (n° 15-15.190 à 15-15.287) à une distinction entre :
- la pertinence des possibilités de reclassement au sein du groupe qui doit s’apprécier parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel et,
- la pertinence des moyens financiers du groupe qui doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du Code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Ainsi, pour apprécier la pertinence des mesures d’un PSE au regard des moyens financiers du groupe, la Cour retient la même définition du groupe que celle adoptée pour l’appréciation du motif économique du licenciement dans son arrêt susvisé du même jour (n° 14-30.063).
Sources : Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 14-30.063, FS-P+B+R+I , Mme X épouse Y c/ Sté Comalin
21/10/2016
Droit du travail
Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
Ces dispositions prévoient que l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, en application du 2° de l'article L. 1235-5 du code du travail, ce montant minimal n'est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
L'entreprise requérante contestait, sur le fondement du principe d'égalité, la différence ainsi instituée entre les entreprises en fonction de la taille de leurs effectifs.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.
Il a d'abord jugé que la différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation. Il a en effet estimé qu'au regard des règles applicables à l'indemnisation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés ne sont pas placés dans une situation différente.
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que la différence de traitement était justifiée par un motif d'intérêt général. Sur ce point, il a considéré qu'en limitant l'application du plancher indemnitaire de six mois de salaire aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées économiquement plus fragiles, ce qui constitue un but d'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de ce plancher indemnitaire en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. Si pour les entreprises d'au moins onze salariés ce plancher a pour objet d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive. Le critère retenu par le législateur est donc en adéquation avec l'objet de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail.
Sources : Décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 - Société Goodyear Dunlop Tires France SA
14/10/2016
Droit du travail
Requalification d’un CDD en CDI - Absence de signature de l’employeur
Le contrat à durée déterminée ne comportant pas la signature de l’employeur doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sources : Soc. 6 octobre 2016, n° 15-20304
14/10/2016
Gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire
Les dispositions relatives à l’inaptitude des salariés (des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail) s'appliquent aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire.
Au visa du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, la Cour de cassation rappelle qu’une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Sources : Soc. 5 octobre 2016, n° 15-22.730, Publié au Bulletin
29/09/2016
Droit du travail
Prise d’acte de rupture - Préavis
La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, après avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limite le montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où la salariée a été embauchée par un autre employeur dès sa prise d'acte de la rupture.
Or, la Cour de cassation rappelle : « le juge qui retient que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », peu importe que le salarié ait retrouvé immédiatement un emploi.
Sources : Soc. 14 septembre 2016, n°14-16663
06/07/2016
Droit du travail
Licenciement pour motif personnel : « immunité » des lanceurs d’alerte en matière d’infractions pénales
Dans un arrêt promis à la plus large diffusion, la Cour de cassation apporte une double précision s'agissant de la protection des lanceurs d'alerte. D'abord, elle décide que « le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ».
Ensuite et surtout, la cour affirme pour la première fois qu'« en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Sources : Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-P+B+R+I
Note explicative de l’arrêt disp. sur www.courdecassation.fr
02/06/2016
Droit du travail
Transfert en application d'un accord collectif : le salarié peut refuser de passer au service du nouveau prestataire
La clause de mobilité par laquelle un salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle.
Sauf application éventuelle de l' article L. 1224-1 du Code du travail , le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
Sources : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.556 à 14-26.576 et 14-26.588, FS-P+B - M. F. et a. c/ Sté Aircar et a.
24/05/2016
Droit du travail
Durée du travail : de la preuve de l’existence d’un temps partiel
À défaut de mentionner la durée de travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat est présumé à temps plein. L'employeur peut néanmoins démontrer qu'il s'agit bien d'un temps partiel en prouvant par tout autre moyen que la durée exacte convenue correspond à un temps partiel et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition. Dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation décide que la production de plannings mensuels comprenant le nom des salariés et les jours travaillés ne permet pas de faire tomber la présomption de travail à temps plein.
Au cas d'espèce et pour fonder leur décision, les juges du fond avaient retenu que l'employeur justifiait que la salariée était informée des jours durant lesquels elle devait travailler dans le mois et selon quel horaire de 24 heures à 4 heures ou de 23 heures à 3 heures, en produisant des plannings mensuels comprenant le nom des salariés et les jours travaillés. De ces éléments les magistrats avaient déduit que l'intéressée, qui travaillait au plus deux jours consécutifs les fins de semaine, ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur puisqu'elle était informée du rythme auquel elle travaillait.
La Cour de cassation désavoue les juges du fond : ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l' article L. 3123-14 du Code du travail , la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé. Il est rappelé par le juge du droit que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Sources : Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496, FS-P+B - Mme F. c/ SARL Garouda - O'Klub
26/04/2016
Droit du travail
Entretien préalable au licenciement : l'employeur n'a pas à indiquer ses griefs contre le salarié dans la lettre de convocation
L'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
L'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
Sources : Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-23.198, 2nd moyen - FS-P+B - M. A. et a. c/ SAS d'exploitation de l'hôtel du parc de Bougival
07/03/2016
Droit du travail
Inconstitutionnalité de la privation d’indemnité de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde
En réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il avait été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de Cassation, le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la Constitution la privation d'indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde ( C. trav., art. L. 3141-26 , al. 2).
Les Sages ont en effet relevé que cette règle ne s'appliquait pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés( C. trav., art. L. 3141-28 ).
Ainsi, en prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés payés conserve son droit à indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, le législateur a traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés.
Jugeant cette différence de traitement sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congés payés, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l' article L. 3141-26 du Code du travail .
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 4 mars 2016, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel. Elle pourra être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Sources : Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC JO 4 mars 2016, texte n° 120 Cons. const., communiqué, 2 mars 2016
02/12/2015
Durée du travail : de la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié
De l' article L. 3171-4 du Code du travail duquel il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties (Cass. soc., 21 sept. 2010, n° 09-41.154 : JurisData n° 2010-016603 ; JCP S 2010, 1453, note T. Lahalle), le juge du droit fournit un guide d'application : il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments(V. déjà, Cass. soc., 24 nov. 2010, n° 09-40.928 : JurisData n° 2010-021943 ; JCP S 2011, 1081, note F. Dumont).
Au cas d'espèce, à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, un salarié invoquait l'existence d'heures supplémentaires non payées. La cour d'appel, pour ne pas faire droit à sa demande, a relevé que celle-ci, étayée par des captures d'écran d'ordinateurs faisant état des dates et des horaires de modification, l'était insuffisamment car rien ne permettait de vérifier que l'intéressé, qui avait une grande liberté dans l'organisation de son travail et qui bénéficiait d'une rémunération variable significative, avait fait des heures supplémentaires à la demande précise de son employeur.
La décision des juges d'appel est censurée, la Cour de cassation considérant qu'il ressortait de leurs propres constatations que les éléments produits par le salarié, qui permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande.
Sources : Cass. soc., 17 nov. 2015, n° 14-15.142, M. A. c/ SASU Computacenter Franc
24/11/2015
Droit du travail
Inaptitude : sanctions en cas de non-respect de l’obligation de reclassement
Ne satisfait pas à son obligation de reclassement, l'employeur qui a convoqué le salarié à un entretien préalable de licenciement le même jour que la seconde visite médicale.
Il est rappelé que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement (V. Cass. soc., 28 janv. 2004, n° 01-46.442 : JurisData n° 2004-022005). La Cour considère qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l' article L. 1226-2 du Code du travail .
Confirmation est donnée que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si le salarié prouve que son reclassement n'a pas été recherché. Pareille preuve est rapportée lorsque l'entretien préalable de licenciement a eu lieu le même jour que la seconde visite médicale(V. déjà, Cass. soc., 9 avr. 2008, n° 07-40.408, inédit).
Sources : : Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-11.879, Mme P. c/ SAS Cabinet Dolleans
20/10/2015
Droit du travail
Rupture du contrat de travail : limitation du recours à la prise d'acte en cas de rupture conventionnelle en cours
Il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.
Par ailleurs, la rétractation devant nécessairement être envoyée à l'autre partie signataire de la rupture conventionnelle en application de l' article L. 1237-13 du Code du travail , elle n'est pas valable si elle est adressée à l'Administration.
Sources : Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-17.539, M. A. c/ sté Méditerranée Var diffusion
06/10/2015
Droit du travail
Dérogations au repos dominical accordées par le maire : quelle majoration de rémunération pour le salarié ?
Selon l' article L. 3132-27 du Code du travail , les salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche délivrée par le maire, doivent bénéficier, d'une part, d'« une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente », d'autre part, d'« un repos compensateur équivalent en temps ». De ce texte il se déduit, pour le juge de cassation, que le bénéfice de cette double contrepartie - en repos et en argent - est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés. Elle n'a pas à être prise en compte pour vérifier que l'obligation légale est respectée.
Sources : Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 13-82.284
09/06/2015
Pénal
Libre administration de la preuve testimoniale des descendants
Le principe en matière d'administration de la preuve devant les juridictions répressives est, selon l' article 427 du Code de procédure pénale , la liberté. Jusqu'à cet arrêt du 2 juin 2015, la liberté de la preuve par témoignage admettait une exception prétorienne issue de l' article 205 du Code de procédure civile . La chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur cette exception.
En l'espèce, une épouse en instance de divorce dépose plainte contre son mari pour des faits de violences physiques et morales subies à répétition, sur plusieurs années. Reconnu « coupable de violences volontaires sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint » par la cour d'appel, le prévenu se pourvoit en cassation arguant que les juges du fond se sont fondés sur des preuves réputées irrecevables car provenant du témoignage des enfants du couple. La Cour de cassation rejette le pourvoi « en raison du principe de la liberté de la preuve » revirant ainsi une position jurisprudentielle vieille de trente-cinq ans (Cass. crim., 5 févr. 1980, n° 79-90.936 : JurisData n° 1980-796047).
Prévu pour la matière correctionnelle, l'importance du principe de la liberté de la preuve est telle qu'il est étendu aux matières contraventionnelle et criminelle (JCl. Procédure pénale, art. 427 à 457, fasc. 20, par H. Pelletier et J.-B. Thierry). Dès lors, « hors les cas où la loi en dispose autrement »( CPP, art. 427 , al. 1er), toutes les preuves « apportées au cours des débats et contradictoirement discutées » sont admises devant le juge pénal ( CPP, art. 427 , al. 2). Parmi les cas non-admis, la Haute juridiction compte celui visé à l' article 205 du Code de procédure civile qui prohibe aux descendants d'être « entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps » (V. Cass. crim., 5 févr. 1980, n° 79-90.936, préc. - Cass. crim., 4 janv. 1985, n° 82-93.066 : JurisData n° 1985-700003 ; JCP G 1985, II, 20521 , note A. Bénabent, R. Lindon). Cette interdiction probatoire est étendue à la procédure pénale au nom d'un « principe fondamental inspiré par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, dont l'application ne saurait être limitée à la procédure civile » (Cass. crim., 4 janv. 1985, n° 82-93.066, préc. - Cass. crim., 4 févr. 1991, n° 89-86.575 : JurisData n° 1991-000976 ; JCP G 1992, II, 21915, note P. Chambon). Reprise à l'identique dans le pourvoi, cette formulation prétorienne empruntée au juge civil (V. par ex. Cass. 2e civ., 23 mars 1977 : JurisData n° 1977-799093. - Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, n° 96-21.110 : JurisData n° 1998-003633) n'empêche pas la chambre criminelle de faire prévaloir le principe de la liberté de la preuve, excluant désormais l'application de l' article 205 du Code de procédure civile devant la juridiction pénale. Par cet arrêt, les Hauts magistrats restaurent la libre administration de la preuve testimoniale en procédure pénale, que le témoignage provienne d'un enfant du couple ou non.
Sources : Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-85.130
28/0552015
Droit du travail
Temps partiel modulé : présomption de temps plein en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations d’information des salariés
En cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet ; il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Sources : : Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.623, SASU Mediapost c/ Mme M. et a.
22/04/2015
Droit du travail
Rémunération revue à la baisse après un changement d’horaires : changement des conditions de travail ou modification du contrat ?
La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2015. Ainsi, l'instauration d'une nouvelle répartition des horaires de travail s'analyse, sauf exceptions, en un simple changement des conditions de travail qui s'impose par conséquent au salarié (V. déjà notamment, Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 97-44.339 : JurisData n° 2000-000576. - Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.702 : JurisData n° 2011-023706 ; JCP S 2012, 1159, étude par H. Kobina Gaba et JCP S 2011, act. 442) et ce, quand bien même celle-ci s'accompagne d'une diminution de rémunération résultant de la perte d'une prime liée à des sujétions ayant disparu dans le cadre du nouvel horaire.
Sources : Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-27.624, FS-P+B - M. C. c/ sté Saint-Gobain
21/04/2015
Droit du travail
Clause de non-concurrence : pas de minoration de la contrepartie en fonction du mode de rupture du contrat de travail
Doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence. La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 9 avril 2015 sa jurisprudence, en rappelant qu'il est interdit de minorer le montant de la contrepartie financière selon le type de rupture du contrat de travail (V. déjà, Cass. soc., 8 avr. 2010, n° 08-43.056, en cas de licenciement pour faute : JurisData n° 2010-003378 ; JCP S 2010, 1288, note par I. Beyneix. - Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 10-11.590, en cas de démission : JurisData n° 2012-000811 ; JCP S 2012, 1208, note par I. Beyneix).
Sources : Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-25.847, M. G. c/ SA Fidecompta
16/04/2015
Droit du travail
Alcoolémie sur le lieu de travail : modalités de contrôle et licenciement disciplinaire
Ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important qu'il s'effectue, pour des raisons techniques, hors de l'entreprise.
Sources : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436, SA Autoroute Paris-Rhin-Rhône c/ M. E. et a.
16/04/2015
Droit du travail - Preuve
Production en justice de documents appartenant à l’employeur et charge de la preuve
Les documents appartenant à l'entreprise subtilisés par un salarié doivent, pour être retenus par la justice, être strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à son employeur à l'occasion de son licenciement. C'est au salarié de rapporter cette preuve. S'il n'y parvient pas, l'employeur peut obtenir la destruction des documents en cause ou de leur copie.
Sources : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410, Sté Maguin c/ M. Zych
13/04/2015
Droit du travail
Requalification du contrat de travail à temps partiel : ce que l’employeur doit démontrer
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. À l'employeur qui conteste cette présomption simple de démontrer, par tous moyens (plannings, etc.), que le contrat a bien été conclu à temps partiel conformément à l' article L. 3123-14 du Code du travail : il doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition (V. déjà, Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-20.627 : JurisData n° 2014-031721 ; JCP S 2015, 1067, note A. Barège. - Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-24.012 : JurisData n° 2013-002725).
Sources : : Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-24.502, M. P. c/ Office du tourisme de Bourges
3/04/2015
Droit du travail
Travail temporaire : quelle sanction en cas d’omission de la mention relative à l’indemnité dite « de précarité » dans le contrat de mission ?
L'absence de mention sur le contrat de mission de l'indemnité de fin de mission implique sa requalification en contrat à durée indéterminée.
La Cour de cassation témoigne, dans un arrêt du 11 mars 2015, de son attachement au formalisme devant accompagner la rédaction des contrats de mission ; doit impérativement y être mentionné l'ensemble des éléments visés à l' article L. 1251-16 du Code du travail , parmi lesquels figure l'indemnité de fin de mission. À défaut, le contrat de mission est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Sources : Cass. soc., 11 mars 2015, n° 12-27.855, SAS Randstad c/ Mme B. et a.
17/03/2015
Social
Rupture du contrat de travail : l’articulation entre licenciement et rupture conventionnelle précisée par la Cour de cassation
Par trois arrêts datés du 3 mars 2015 (n° 13-20.549, n° 13-15.551 et n° 13-23.348), la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit l'édification de sa jurisprudence relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Dans la première affaire (arrêt n° 13-20.549), la Cour pose le principe qu'il est possible de conclure une rupture conventionnelle postérieurement à la notification d'un licenciement. La rupture conventionnelle vaut alors renonciation commune des parties à ce dernier.
Dans le deuxième arrêt (n° 13-15.551), le juge du droit décide que la signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas nécessairement renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire : si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable et sous réserve du respect du délai de prescription des faits fautifs de deux mois.
Dans le troisième et dernier arrêt (n° 13-23.348), la Cour de cassation pose le principe que la signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l' article L. 1332-4 du Code du travail .
6/03/2015
Procédure pénale
Arrêt d’assemblée plénière
Pourvoi n° N14-84.339
Le principe de loyauté dans la recherche des preuves est réaffirmé et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est consacré.
Les faits
Sur ordonnance motivée du juge d’instruction prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, des enquêteurs ont placé en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, deux personnes soupçonnées d’avoir participé à un vol avec armes en bande organisée. Ces deux personnes ayant communiqué entre elles pendant leurs périodes de repos, des propos par lesquels l’une d’entre elles s’auto-incriminait ont été enregistrés et versés au dossier.
Le contexte juridique
Si l’article 427 du code de procédure pénale prévoit que les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve, la liberté de la preuve en matière pénale qui résulte de ce texte n'est pas absolue. Elle se trouve nécessairement limitée, dans un État de droit, par les principes de légalité et de loyauté.
La Cour de cassation a dégagé très tôt le principe de loyauté, qu’elle applique aussi bien à l’information judiciaire qu’à l’enquête de police.
De plus, la loi prévoit expressément le droit de se taire pour une personne placée en garde à vue.
Le droit de se taire et celui de ne pas s'auto-incriminer sont d’ailleurs reconnus depuis longtemps par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Cour européenne des droits de l’homme.
La question posée à la Cour
Les conditions dans lesquelles les enregistrements ont été effectués portaient-elles atteinte au principe de loyauté des preuves, au droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer ?
La décision de la Cour
Le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions de deux personnes en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un stratagème. Ce procédé d’enquête est déloyal : il met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s’incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves.
25/02/015
Copropriété
Horaires de fermeture de la barrière automatique d’une copropriété : majorité requise en AG
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d'une assemblée générale relative à la fermeture de la copropriété par une barrière automatique (l'accès piéton par le trottoir étant laissé libre), et de la décision de laisser la barrière fermée en permanence.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 7 sept. 2012) annule cette délibération en ce qu'elle a décidé que la barrière restera fermée en permanence.
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. En application de l'article 26 e de la loi du 10 juillet 1965, devenu 26 c, de la même loi en application de l'article 59 de la loi du 24 mars 2014, les décisions relatives aux modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. La cour d'appel a constaté que les copropriétaires avaient décidé de la fermeture de la copropriété par une barrière automatique avec commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs. Elle a relevé qu'en vertu de l'ordre du jour de l'assemblée générale, les copropriétaires avaient délibéré sur les modalités de fonctionnement de la barrière et notamment sur les horaires de fermeture et décidé qu'elle resterait fermée en permanence, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette décision devait être votée à la majorité qualifiée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Sources : Cass. 3e civ., 18 févr. 2015, n° 13-25.974
03/06/2014
Civil
Calcul de la prestation compensatoire : l’article 272, alinéa 2, du Code civil jugé inconstitutionnel
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l' article 272 du Code civil .
Cet article relatif à la fixation de la prestation compensatoire qui peut être prononcée à l'occasion du divorce dispose en son second alinéa que : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ». le Conseil constitutionnel, considère que l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, des sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives et que, par suite, cette interdiction méconnaît l'égalité devant la loi. Il déclare donc ces dispositions contraires à la Constitution.
En effet, selon le Conseil constitutionnel, d'une part, en excluant des éléments retenus pour la calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, le second alinéa de l' article 272 du Code civil empêche de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution. Et d'autre part, en application de l' article 271 du Code civil , il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé. En excluant la prise en considération des sommes versées à titre de compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées, ont pour effet d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que l'abrogation du second alinéa de l' article 272 du Code civil prend effet à compter de la publication de sa décision et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent en revanche être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
JCl. Divorce, synthèse 30
Sources : Cons. Const., 2 juin 2014, déc. n° 2014-398 QPC
21/05/2014
Social
Effets d’une démission intervenue au cours d’une action en résiliation judiciaire
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
Toutefois si, à la demande du salarié, la démission a été requalifiée en prise d'acte par le juge, celui-ci doit, pour l'appréciation du bien-fondé de la prise d'acte, prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
Un salarié saisit la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur dont il a été débouté le 20 janvier 2011, décision dont il a interjeté appel le 22 février 2011. Le 18 mai 2011, il a démissionné sans réserve, sa démission prenant effet le 22 juin 2011.
L'affaire parvient jusqu'à la Cour de cassation qui, pour la première fois, a eu à se pencher sur la question de l'effet d'une démission intervenue au cours d'une action en résiliation judiciaire. Elle décide, de manière inédite, que, dans cette hypothèse, le juge n'a pas à statuer sur la demande de résiliation car le contrat de travail a déjà été rompu par la démission du salarié. Ce dernier peut seulement obtenir des dommages et intérêts « si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés ». Le juge du droit envisage toutefois un second scénario, plus favorable au salarié : si ce dernier a demandé la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, l'action en résiliation est là encore « sans objet » ; mais le juge devra se prononcer sur le bien-fondé de la prise d'acte - en se fondant sur des manquements y compris postérieurs à l'introduction de l'action en résiliation judiciaire - et lui faire produire, selon les cas, soit les effets d'une démission (manquement injustifié), soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat).
JCl. Travail Traité, synthèse 150
Sources : : Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 13-10.772, JurisData n° 2014-008576
06/05/2014
Procédure devant la Cour d’appel
Décret Magendie : articulation entre les articles 908, 909 et 911 du Code de procédure civile
Par deux arrêts du même jour, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences d'une constitution de l'intimé postérieurement à la remise par l'appelant de ses conclusions au greffe.
I. Si l'appelant a fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire à l'intimé il n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de l'intimé qui s'est constitué postérieurement à la délivrance de l'acte. Le délai de l' article 909 du Code de procédure civile court à compter de ladite signification. Un piège peut exister s'il y a un décalage entre l'envoi à l'huissier et la date de délivrance de la signification. L'avocat de l'appelant doit vérifier si dans ce laps de temps une constitution est intervenue. L'interprétation a contrario de l'arrêt, conforme à la lettre de l'article 911 in fine du Code de procédure civile, implique que seule la notification à avocat est alors valable... Cela nécessite une sérieuse vigilance. Au-delà, ne pourrait-on pas reprocher à l'avocat qui se constitue tardivement de ne pas avoir averti son confrère comme l'exige l' article 903 du Code de procédure civile ? Cette carence ne pourrait-elle pas permettre à l'appelant d'échapper à la caducité de sa déclaration d'appel faute d'avoir notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé dont il ignorait qu'il était constitué?
II. Selon la Cour de cassation, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois (3+1) à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions à l'avocat qui s'est constitué postérieurement au dépôt des conclusions de l'appelant au greffe. Cet arrêt est rendu au visa de l' article 911 du Code de procédure civile dont il n'est pas certain qu'une lecture littérale permette de dégager une telle solution. Il reste cependant possible qu'entre-temps l'appelant ait signifié ses conclusions à la partie adverse...ce qui nous ramène à l'hypothèse précédente. Tous les cas de figure sont envisageables. Le décret Magendie est bien une succession de chausse-trappes...
Philippe Gerbay, maître de conférences, faculté de droit de Dijon, avoué à la Cour honoraire.
Sources : Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 12-29.333 JurisData n° 2014-007070 : Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 12-29.333 JurisData n° 2014-007069
03/12/2013
Immobilier
Formalisme et contrat de construction de maison individuelle
L' article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation énumère les énonciations que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'« il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doit fournir une étude de sol » en censurant la décision qui avait mis le paiement du coût de cette étude à sa charge.
Mme X, maître de l'ouvrage, avait, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société PCA maisons de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. Des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n'ayant pas été poursuivi, le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur en nullité du contrat et indemnisation de ses préjudices. Ce dernier a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et en paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel ayant dit nul le contrat de construction de maison individuelle, le constructeur s'est pourvu en cassation et le maître de l'ouvrage a formé un pourvoi incident en contestant notamment que le paiement du coût de l'étude du sol reste à sa charge.
La Cour de cassation rejette le pourvoi principal du constructeur mais prononce cependant une cassation partielle sur le pourvoi incident du maître de l'ouvrage.
Sources : Cass. 3e civ., 20 nov. 2013, n° 12-27.041
03/12/2013
Social
CDD : le refus par le salarié d’un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave
Par deux arrêts du 20 novembre 2013, la Cour de cassation retient qu'un refus de changement des conditions de travail ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée.
• Dans la première espèce (n° 12-16.370), une salariée est engagée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à durée déterminée par une commune, pour exécuter des tâches de secrétariat au service des marchés publics. Quelques mois après, l'employeur l'informe de son affectation au service des affaires générales. La salariée ayant refusé sa nouvelle affectation, l'employeur prononce la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. La salariée saisit alors la juridiction prud'homale.
Au soutien de son pourvoi, la commune fait grief à la cour d'appel de Riom d'avoir retenu que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, aux motifs, d'une part, que l'indication des tâches dans le contrat de travail n'avait qu'une valeur informative, et non contractuelle, d'autre part, qu'un salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être affecté à des tâches relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la chambre sociale, qui rappelle, « d'une part, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, d'autre part, que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ». En l'espèce, la salariée ayant vu son contrat de travail rompu de manière anticipée pour faute grave à la suite de son refus d'affectation au service des affaires générales, la faute grave ne pouvait être retenue, de sorte que l'employeur n'était pas fondé à rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme.
• Dans la seconde espèce (n° 12-30.100), une salariée est engagée par une association dans le cadre d'un contrat emploi solidarité en qualité d'agent d'entretien, puis dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le lieu de travail est fixé au siège de l'association à Marseille. L'employeur ayant rompu de manière anticipée le contrat de travail pour faute grave, tirée d'un refus de la salariée de se rendre sur un nouveau lieu de travail, cette dernière saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture.
Pour la débouter de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel retient la faute grave, rendant impossible le maintien au sein de l'entreprise, en raison du refus injustifié de la salariée de se rendre sur un nouveau lieu de travail, distant de l'ancien de quinze kilomètres, relevant du même secteur géographique. L'arrêt, rendu au visa de l'article L. 1243-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, énonce que « le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ».
Sources : : Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 12-16.370, Commune de Moulins c/ Mme G JurisData n° 2013-026179 : Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 12-30.100, Mme Z. c/ Assoc. pompiers sans frontières JurisData n° 2013-026208
03/12/2013
Pénal
Non-paiement de pension alimentaire : relaxe du chef d’abandon de famille dès lors que l’élément intentionnel n’est pas caractérisé
Dans une décision du 6 novembre 2013, la cour d'appel de Chambéry a relaxé le prévenu du chef d'abandon de famille. Le défaut de mise en œuvre d'une procédure de réduction ou de suppression de la pension alimentaire devant le JAF ne suffit pas à retenir la culpabilité du prévenu pour abandon de famille.
Le prévenu qui n'a pas payé la pension alimentaire de la fille qu'il a eue avec son ex-amie doit être relaxé du chef d'abandon de famille, dès lors que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé. Le prévenu se trouve dans l'impossibilité absolue de payer. Il habite chez sa mère, ne pouvant payer de loyers, et n'a pour seul revenu que le RSA. Un jugement du juge aux affaires familiales a retenu l'existence d'un état d'impécuniosité justifiant la suppression de la pension alimentaire mais a toutefois limité la rétroactivité de la suppression de ladite pension à la date du dépôt de la requête du prévenu, soit le 12 février 2013, celui-ci n'ayant pas saisi plus tôt le JAF pour faire supprimer la part contributive fixée. Cet argument ne saurait être retenu, dès lors que la jurisprudence considère que ne justifie pas sa décision la juridiction qui se borne à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu au niveau de l'élément intentionnel, que ce dernier ne justifie pas avoir mis en œuvre, devant le JAF, une procédure de réduction ou de suppression de la pension alimentaire.
Décision antérieure :
- TGI Chambéry, jug., 18 avr. 2013
Voir aussi :
- CA Rennes, 3e ch. corr., 11 avr. 2008, n° 07/01280 : JurisData n° 2008-364511
Sources : : CA Chambéry, 6 nov. 2013, n° 13/00532 JurisData n° 2013-026680
21/05/2013
Famille
Procédure de divorce : la pension alimentaire prend fin au jour où le divorce devient irrévocable
La pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable. C'est ce qu'affirme la Cour de cassation, dans cet arrêt rendu au visa des articles 254 et 255 du Code civil, 1121 et 1122 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
À la suite du prononcé du divorce de deux époux, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 26 septembre 2011, a décidé que le conjoint était créancier de son épouse à hauteur de la somme de 27 945, 67 euros au titre d'un trop versé de pension alimentaire, pour la période allant de l'ordonnance de non-conciliation à la date à laquelle le divorce a été prononcé.
La Haute cour estime qu'en statuant ainsi, alors que la pension alimentaire ne cessait d'être due qu'à l'issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l'arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt d'appel est donc cassé sur ce point.
Source
Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 12-11.516, F P+B+I
03/12/2012
Consommation
Délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur
En vertu de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Suivant acte authentique du 27 mai 2003, l'intéressé a souscrit deux emprunts auprès d'une banque ; la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d'impayés ; le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Pour le débouter de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l'arrêt attaqué a retenu que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013.
En statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 précité.
Source
Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.508, FS P+B+I X c/ Sté Banque Kolb
10/07/2012
Procédure pénale
La Cour de cassation interdit la garde à vue des sans-papiers
Par trois arrêts du 5 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation interdit la garde à vue d'étrangers pour seul motif de séjour irrégulier en France.
Les faits qui ont donné lieu à cette affirmation sont similaires dans ces trois espèces : il s'agissait de personnes étrangères, en situation irrégulière en France, interpellées en état de flagrance, placées en garde à vue pour séjour irrégulier en France et à l'égard desquelles un arrêté de reconduite à la frontière fut pris, avec décision de placement préalable en rétention administrative.
Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 28 avr. 2011, C-61/PPU. - CJCE, 6 déc. 2011, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement :
- soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives,
- soit a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure.
La Cour de cassation rappelle ici qu'une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement et qu'au surplus cette mesure doit obéir à l'un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale. Elle en déduit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef.
La première chambre civile de la Cour de cassation s'aligne ainsi sur la position de la chambre criminelle exprimée en la matière dans son avis du 5 juin 2012 (Cass., avis, 5 juin 2012, n° 9002 : JurisData n° 2012-011915)
Source
Cass. 1re civ., 5 juill. 2012, n° 11-30.371, 11-19.250 et 11.30-530 : JurisData n° 2012-014962, 2012-014964 et 2012-014965
21/03/2012
Civil
Admission de la nationalité française par l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'une personne elle-même admise à la citoyenneté française
Un algérien, M. X. a engagé une action déclaratoire de nationalité française, en se fondant sur un décret du 21 janvier 1885 déclarant son arrière-grand-père citoyen français ainsi que sur le mariage de ses grands-parents et parents. La cour d'appel ayant déclaré Monsieur X. de nationalité française, le procureur général près la cour d'appel se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation, après avoir affirmé que les dispositions de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ne peuvent être opposées par le ministère public à la partie qui se prévaut d'actes d'état civil algériens modifiés par des décisions algériennes dès lors qu'il ne conteste pas la régularité de ces actes ainsi modifiés (ces dispositions édictant des formalités à l'accomplissement desquelles est subordonnée l'exécution en France d'une décision algérienne), ajoute qu'en raison de leur caractère déclaratif, les jugements supplétifs qui constatent le mariage des grands-parents de l'intéressé célébré avant sa naissance ou précisent l'état civil de son arrière-grand-père, en l'absence de contestation de leur régularité, apportent la preuve de l'antériorité de l'existence de l'évènement à sa naissance et partant, de sa filiation légitime, peu important que ces jugements aient été prononcés pendant la majorité de l'intéressé.
Enfin, la Haute cour relève qu'au regard des règles relatives au mariage putatif et dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation, la célébration du mariage du père de l'intéressé devant le cadi et non devant un officier de l'état civil, eût-elle affecté la validité du mariage, était sans incidence sur la transmission à son fils du statut civil de droit commun. Or, l'intéressé ayant établi le lien de filiation le liant à son arrière-grand-père, lui-même admis à la citoyenneté française, avait donc conservé de plein droit la nationalité française. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.
Source
Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-30.133
21/03/2012
Travail
Absence de CDD signé : seule l'intention frauduleuse peut empêcher la requalification
La signature d'un CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en CDI. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Une salariée, engagée en contrat à durée indéterminée et à temps partiel, demande, à l'échéance de son contrat, la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle soutien qu'aucun contrat n'ayant été signé entre les parties, il en résulte que les dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail trouvent à s'appliquer. La cour d'appel refuse de faire droit à ses demandes, au motif que l'absence de contrat signé entre les parties trouve sa justification dans le refus même de la salariée de les signer. En effet, les divers contrats à durée déterminée écrits ont bien été remis à la salariée, mais celle-ci a refusé de les rendre, malgré rappel par courrier recommandé resté sans effet. Elle ne peut en conséquence se prévaloir du défaut de signature qui lui incombe.
L'arrêt est cependant cassé par la chambre sociale, qui rappelle que « la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ». Cependant, il en va autrement « lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ». En l'espèce, malgré les constats de la cour d'appel relevant le silence gardé par la salariée aux sollicitations de son employeur relatives à la remise de ses contrats signés, la mauvaise fois ni l'intention frauduleuse de la salariée n'a été caractérisée.
La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans afin de rechercher l'intention frauduleuse de la salariée, qui seule serait de nature à empêcher une disposition d'ordre public de s'appliquer.
Source
Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, FS-P+B, Assoc. Union lassallienne d’éducation c/ Mme C. : JurisData n° 2012-003576
02/03/2012
Pénal
Possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur
Le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012 (amende prévue pour les contraventions de la première classe).
Ce décret oblige tout conducteur d'un véhicule (à l'exclusion d'un cyclomoteur) à posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel (C. route, art. R. 234-7).
Le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif est réputé en règle.
Source
D. n° 2012-284, 28 févr. 2012 : JO 1er mars 2012, p. 3935
20/02/2012
Famille
Précisions sur la notion de prestation compensatoire
Par plusieurs décisions du 15 février 2012, la Cour de cassation précise sa définition de la prestation compensatoire et rappelle que le juge la fixe en tenant compte de la situation respective de chacun des époux au moment du divorce.
Ainsi, ne peuvent être pris en considération dans le calcul de cette prestation compensatoire des revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté alors que, pendant la durée du régime, ces biens entrent en communauté et non pas dans le patrimoine propre de l'époux et qu'après la dissolution, ils accroissent à l'indivision (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 10-20.018).
De la même façon, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants et qui, à ce titre, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n°11-11.000).
Enfin, ne peuvent figurer au titre des revenus de l'époux les loyers d'un immeuble commun qui lui sont dévolus sans rapport à la communauté au titre du devoir de secours. Les juges ne peuvent, en effet, se fonder sur l'avantage constitué au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au moment de la rupture du mariage (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n°11-14.187).
Source
Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 10-20.018
Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-11.000
Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-14.187
05/01/2012
Actions en justice et taxe de 35 euros
Contexte. - La loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et le décret d'application du 28 septembre 2011 ont créé une nouvelle taxe obligatoire de 35 € pour toute action en justice dans les domaines civil, commercial, prud'homal, social, rural ou de droit administratif. Destinée à rémunérer les avocats intervenant lors des gardes à vue, au titre de l'aide juridictionnelle, elle est applicable à toutes les actions introduites depuis le 1er octobre 2011. Seules les personnes bénéficiaires de l'aide juridique sont exemptées de cette taxe.
À compter du 1er janvier 2012. - À partir de cette date la représentation devant la cour d'appel sera assurée par les avocats, ces derniers devront effectuer en matière civile les déclarations d'appel et les constitutions d'intimé obligatoirement par la voie électronique depuis le service e-barreau, en exécution des dispositions de l'article 930-1 du CPC. C'est également à cette date que les justiciables qui font appel d'une décision dans une procédure imposant l'assistance d'un avocat devront verser, en plus des 35 €, un droit supplémentaire de 150 € affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel.
Entrée en vigueur du timbre dématérialisé. - Les timbres qui étaient jusqu'à présent uniquement disponibles au format papier et apposés sur les pièces de procédure, pourront courant janvier 2012 être joints par voie électronique depuis le service e-barreau :
- aux déclarations d'appel et constitutions d'intimé,
- mais également sur les inscriptions à une audience de référés ou le placement au fond d'une assignation devant le tribunal de grande instance.
La date annoncée par le Ministère de la justice et des libertés est actuellement fixée au 16 janvier 2012 (un site dédié à l'achat de timbres fiscaux est actuellement développé par les services du ministère de la Justice et des libertés. Accessible à partir du portail du Ministère de la justice, il sera très prochainement mis à la disposition des avocats et des justiciables).
Source
CNB, communiqué, 3 janv. 2012
04/01/2012
Procédure pénale
Décret du 28 décembre 2011 modifiant le Code de procédure pénale et relatif à l'application des peines
Le décret n° 2011-1986 du 28 décembre 2011 détermine les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions du Code de procédure pénale (CPP) relatives à l'application des peines issues de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
Information des victimes. - L'article 2 précise les modalités selon lesquelles les victimes qui le souhaitent peuvent être informées de la date de libération d'un condamné ou de la date à laquelle prend fin un sursis avec mise à l'épreuve (SME), conformément au dernier alinéa de l'article 712-16-2 et à l'article 745 du CPP.
Modalités d'octroi des libérations conditionnelles. - L'article 3 précise les modalités d'octroi d'une libération conditionnelle concernant les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, à une peine privative de liberté supérieure ou égale à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire n'est pas encouru, ou encore à une peine de 10 ans ou plus pour les crimes sexuels les plus graves, en application de l'article 730-2 du CPP.
Modalités du suivi des condamnés après leur libération. - L'article 4 précise les modalités de convocation, avant leur libération, devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un SME, en application de l'article 741-1 du CPP.
Aménagements de peine spécifiques octroyés par le JAP. - L'article 5 dispose que le juge de l'application des peines est compétent pour accorder, s'il y a lieu, un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5 du CPP (réductions de peine, autorisations de sorties sous escortes et permissions de sortir).
Placement sous surveillance judiciaire.- L'article 5 prévoit également la transmission par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au procureur de la République et aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, de la copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à 5 ans lorsque les faits ont été commis en récidive et si la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
Source
D. n° 2011-1986, 28 déc. 2011 : JO 29 déc. 2011, p. 22575
04/01/2012
Procédure administrative
Les nouvelles règles de procédure devant les juridictions administratives
Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011, publié au Journal officiel du 27 décembre, modifie le Code de justice administrative.
Il généralise, selon les termes de sa notice, et dès le 1er janvier 2012, l'expérimentation permettant aux parties, à l'audience, de présenter en dernier leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Il porte aussi application de l'article L. 732-1 du Code de justice administrative en déterminant notamment les matières dans lesquelles le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; il s'agit des contentieux suivants (art. 8) :
- permis de conduire ;
- refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
- naturalisation ;
- entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
- taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du Code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
- aide personnalisée au logement ;
- carte de stationnement pour personne handicapée.
Le décret autorise la consultation exceptionnelle du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par visioconférence et, le cas échéant, par écrit (art. 12). Il interdit aux membres du Conseil d'État participant au jugement d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'État de prendre connaissance de cet avis s'il n'a pas été rendu public (art. 13). Il prévoit enfin la compétence du tribunal administratif de Nancy pour connaître des recours des requérants placés au centre de rétention de Metz (à partir du 1er mars 2012 pour les requêtes introduites à compter de cette date).
Source
D. n° 2011-1950, 23 déc. 2011 : JO 27 déc. 2011, p. 22294
04/01/2012
Profession
Modification du régime des spécialisations des avocats
Pris pour l'application de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, le décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 réforme le régime des mentions de spécialisation des avocats.
Il remplace l'examen de contrôle théorique des connaissances par un entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention du certificat de spécialisation, dont les modalités sont précisées par arrêté (A. 28 déc. 2011 : JO 29 déc. 2011).
Il définit les modalités de dépôt et d'examen des candidatures ainsi que la composition du jury d'entretien et le rôle du Conseil national des barreaux. Il précise également que les anciens avoués et leurs anciens collaborateurs, qui entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel, n'ont pas à se soumettre à de nouvelles conditions d'examen, notamment l'entretien de validation des compétences prévu pour les avocats en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation.
Par ailleurs, un régime de péremption du droit de faire usage d'une mention de spécialisation en cas de non-respect de l'obligation de formation continue est créé.
Enfin, ce décret détermine les conditions d'élection et la durée du mandat du vice-bâtonnier ainsi que les conditions dans lesquelles est établie la liste des personnes auxquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs en matière d'arbitrage.
Ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2011. Cependant, les dispositions relatives à la publication de la liste nationale des avocats admis à se prévaloir d'une mention de spécialisation ainsi que la liste nationale des personnes pouvant être désignées membres d'un jury de spécialisation, en tant qu'elles s'appliquent à la spécialisation en procédure d'appel, entreront en vigueur le 1er janvier 2012. Il en est de même pour les dispositions relatives aux anciens avoués ayant fait le choix de devenir avocats. Les nouvelles dispositions relatives au vice-bâtonnier s'appliqueront quant à elles, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier suivant la publication du présent décret.
Source
D. n° 2011-1985, 28 déc. 2011 : JO 29 déc. 2011
22/11/2011
QPC
La garde à vue constitutionnelle à une réserve près
Saisi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité relatives au régime de la garde à vue, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 62, 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2 et 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale (CPP), en émettant cependant une réserve sur la constitutionnalité de l'article 62 relatif à « l'audition libre ».
À la suite de la décision de censure de plusieurs articles du CPP relatifs à la garde à vue, dont l'article 62, par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 (Cons. const., déc. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC ; JCP G 2010, act. 914), la loi du 14 avril 2011 (L. n° 2011-392 : JO 15 avr. 2011, p. 6610 ; JCP G 2011, doctr. 665 ; JCP G 2011, act. 542), a inséré les articles 63-3-1, 63-4 et 63-4-1 à 63-4-5 dans le CPP pour assurer la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la garde à vue. En outre, il résulte de l'article 62 du CPP qu'une personne peut être entendue en dehors du régime de la garde à vue, lorsqu'il existe « des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre » une infraction, dès lors qu'elle n'est pas maintenue à la disposition des enquêteurs sous la contrainte.
« L'audition libre » : réserve d'interprétation. - Le Conseil émet une réserve quant à la conformité à la Constitution du second alinéa de l'article 62, permettant le régime de « l'audition libre ». Si aucune exigence constitutionnelle n'impose l'assistance effective d'un avocat, le Conseil juge qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.
Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du CPP ne méconnaissent pas les droits de la défense.
La garde à vue conforme à la Constitution. - Les requérants faisaient valoir que les dispositions du CPP restreignent l'assistance par un avocat de la personne gardée à vue, notamment en ce que l'avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que certaines pièces, dont le procès-verbal de placement en garde à vue, et non l'ensemble du dossier. Rappelant la nature de la garde à vue, qui est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judicaire, le Conseil constitutionnel rejette les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale.
De la même manière, le Conseil juge que les dispositions relatives à l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat assurent, entre le droit de cette personne à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il en va de même des dispositions relatives à l'éventuel report de l'entretien entre cette personne et son avocat.
Source
Cons. const., déc. 18 nov. 2011, n° 2011-191/194/195/196/197 QPC Min. Justice, 18 nov. 2011, communiqué
09/11/2011
Social
Accidents du travail : le droit à indemnisation au titre de la perte des droits à la retraite est né
Un salarié embauché en qualité d'aide cisailleur est victime d'un accident du travail entraînant la perte de plusieurs doigts d'une main. À la suite de cet accident, il est licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Il saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le TASS fait droit à sa demande, et alloue au salarié une rente majorée à son maximum et une indemnité pour perte de possibilité de promotion professionnelle. Le salarié saisit ensuite les juridictions du travail, en vue d'obtenir une indemnisation supplémentaire résultant de sa perte de droit à la retraite. La cour d'appel déboute le salarié de cette dernière demande (CA Lyon, 21 mai 2010, n° 09/04130) mais cette décision est sanctionnée par la Cour de cassation, qui estime que « le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'avait pas été réparé par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ». Une indemnité supplémentaire lui reste donc due à ce titre.
Source
Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-20.991, FS-P+B, M. H. c/ Sté Adrien Targe : JurisData n° 2011-023244
03/11/2011
QPC
Frais devant les juridictions pénales : atteinte à l'équilibre des droits des parties
L'article 800-2 du Code de procédure pénale ouvre la possibilité à une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie, qui en fait la demande, une indemnité mise à la charge de l'État. Et, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, l'article 800-2 réserve également la possibilité d'obtenir le remboursement des frais exposés pour sa défense à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.
Le 21 octobre 2011, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 475-1 et 800-2 du CPP aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel, après avoir jugé que l'article 475-1, qui ouvre à la partie civile la faculté de demander au juge que la personne condamnée lui verse une indemnité au titre de ses frais irrépétibles (essentiellement des frais d'avocat). ne méconnaissait aucune disposition constitutionnelle, a déclaré l'article 800-2 contraire à la Constitution pour atteinte à l'équilibre des droits des parties.
Il a en effet jugé que la possibilité donnée par l'article 800-2, à la personne poursuivie ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, d'obtenir le remboursement des frais exposés pour sa défense par la partie civile lorsque celle-ci a mis en mouvement l'action publique, prive les autres parties appelées au procès pénal de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais lorsque, pour un autre motif, elles n'ont fait l'objet d'aucune condamnation.
Le Conseil a reporté la date de l'abrogation de cet article au 1er janvier 2013 afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.
Source
Cons. const., déc. 21 oct. 2011, n° 2011-190 QPC
30/09/2011
Procédure
Nouvelles taxes acquittées par les justiciables : modalités d'application
Un décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 précise les modalités de mise en œuvre de la contribution pour l'aide juridique, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011, en application de la loi n? 2011-900 du 29 juillet 2011 (JO 30 juill. 2011, p. 12969), ainsi que du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel, applicable à compter du 1er janvier 2012. Le Conseil national des barreaux (CNB) a d'ores et déjà annoncé qu'il allait déposer un recours devant le Conseil d'État contre ce texte.
Une taxe de 35 euros, due par la partie qui introduit l'instance, sera désormais exigible lors de l'introduction de toute instance devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.
La contribution n'est pas due en particulier, par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, par l'État, dans le cadre des procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ou pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
Le décret modifie le Code de procédure civile et le Code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en œuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant.
Il est, par ailleurs, institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par le présent décret.
Source
D. n° 2011-1202, 28 sept. 2011 : JO 29 sept. 2011, p. 16383
26/08/2011
Aide juridique
Une contribution pour l'aide juridique de 35 €
L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 introduit, à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, une contribution pour l'aide juridique de 35 € qui sera perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
La contribution, due par la partie qui introduit une instance, est exigible lors de l'introduction de l'instance, à compter du 1er octobre 2011. Toutefois, la contribution n'est pas due :
- par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
- par l'État ;
- pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles
- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
- pour les procédures des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (juge des référés statuant dans l'urgence) ; 515-9 du Code civil (mesures de protection des victimes de violence) ; L. 34 du Code électoral (personnes omises sur les listes électorales).
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution seront fixées par voie réglementaire.
La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux (CNB). Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Il est précisé, par ailleurs, que la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État.
Source
L. n° 2011-900, 29 juill. 2011 : JO 30 juill. 2011, p. 12969
22/08/2011
Bail d'habitation
Procédure de résiliation du bail d'habitation pour abandon et reprise subséquente des lieux
Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 est relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon. Il est pris pour l'application des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est entré en vigueur le 13 août 2011.
Ce décret organise les modalités de résiliation du bail (chapitre Ier) ainsi que la reprise des lieux abandonnés (chapitre II). Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation, il est désormais possible de former cette demande par requête. Le tribunal se prononce alors sans débat préalable sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d'autres sommes dues au titre du contrat de bail, ainsi que sur l'abandon des meubles dénués de valeur. Une opposition à cette décision peut être formée par le locataire ou le dernier occupant de son chef, dans le mois suivant sa signification, faute de quoi elle a force de chose jugée. Si le locataire est dans l'impossibilité de former cette opposition dans ce délai sans faute de sa part, il peut obtenir un relevé de forclusion. Une fois l'ordonnance passée en force de chose jugée, le bailleur peut reprendre son bien suivant une procédure d'expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué. S'il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartient au juge de l'exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d'expulsion, sous réserve de quelques ajustements. Enfin, la procédure de reprise des lieux nécessite d'adapter certaines règles prévues dans le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Les modalités de reprise d'un local abandonné après signification d'une décision d'expulsion et commandement d'avoir à libérer le local sont précisées.
Source
D. n° 2011-945, 10 août 2011 : JO 12 août 2011, p. 13848
19/08/2011
Pénal
Création du tribunal correctionnel pour mineurs
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (JO 11 août 2011, p. 13744) modifie l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en créant une nouvelle juridiction, le tribunal correctionnel pour mineurs. Ce tribunal est une formation spécialisée du tribunal correctionnel (COJ, art. L. 251-7 ; L. 10 août 2011, art. 51) composée de trois magistrats. L'article 49 de la loi a prévu qu'il serait présidé par un juge des enfants mais cette disposition a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 août 2011 (Déc. n° 2011-635 DC, 4 août 2011 : JO 11 août 2011, p. 13763, § 53) rendue au sujet de cette loi, à la suite de sa décision du 8 juillet 2011 (Cons. const., 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC : JO 9 juill. 2011, p. 11979). Cependant, comme l'a prévu cette dernière décision, l'inconstitutionnalité ne vaudra qu'à compter du 1er janvier 2013. On notera également que le tribunal correctionnel pour mineurs comportera les deux citoyens assesseurs prévus par le nouvel article 399-1 du Code de procédure pénale, créé par l'article 5 de la loi, afin de juger les délits énumérés par le nouvel article 399-2 (L. 10 août 2011, art. 49 ; Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-4).
Le tribunal correctionnel pour mineurs est compétent pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale. Il pourra également juger les délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci (Ord. 2 févr. 1945, art. 24-1). Il peut être saisi exclusivement par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction (Ord. 2 févr. 1945, art. 24-2), les dispositions de l'article 49 de la loi, prévoyant la possibilité de sa saisine directe sans instruction, ayant été censurées par le Conseil constitutionnel (Déc. n° 2011-635 DC, 4 août 2011, § 52). Le nouvel article 24-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 énonce que si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19 ainsi qu'une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.
La loi a également modifié l'article 9, 3° de l'ordonnance afin de prévoir que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu'il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le juge d'instruction est tenu de renvoyer l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour mineurs (L. 10 août 2011, art. 34). En outre, dans le même cas, le juge des enfants ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs (L. 10 août 2011, art. 32 ; Ord. 2 févr. 1945, art. 8). On peut en déduire que le tribunal correctionnel pour mineurs possède une compétence exclusive pour juger les mineurs concernés.
On notera enfin que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2012 (L. 10 août 2011, art. 54).
Source
L. n° 2011-939, 10 août 2011 : JO 11 août 2011
12/07/2011
QPC
Le cumul des fonctions d'instruction et de jugement du juge des enfants déclaré contraire à la Constitution
Alors que le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs est actuellement débattu devant le Parlement, le législateur va devoir réorganiser la composition du tribunal pour enfants (TPE).
Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par une importante décision du 8 juillet 2011, a en effet déclaré l'article L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire, contraire à la Constitution tout en reportant son abrogation au 1er janvier 2013.
Aux termes de cette disposition, « le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs ».
Selon le Conseil, le fait que le TPE soit composé majoritairement d'assesseurs non professionnels n'encourt pas la censure dans la mesure où il s'agit d'une juridiction pénale spécialisée dont les conditions satisfont au principe d'indépendance et aux exigences de capacité.
En revanche, le cumul des fonctions d'instruction et de jugement du juge des enfants est jugé contraire au principe d'impartialité. Plus particulièrement, c'est le fait que le juge des enfants instruise sur les faits (et non qu'il instruise sur la personnalité) et qu'il décide du renvoi devant le TPE, juridiction de jugement qu'il préside, qui est déclaré inconstitutionnel.
01/06/2011
Social
Droit pour le salarié à indemnisation pour perte de chance d'utiliser son DIF en cas de prise d'acte de la rupture du contrat justifiée
Un salarié, s'estimant lésé par une modification de la structure de sa rémunération, saisit les juridictions prud'homales afin de voir la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement injustifié.
Sur ce premier moyen avancé par le salarié, la Cour de cassation confirme une jurisprudence établie : la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, ni dans son montant ni dans sa structure.
Plus originale est la décision de la Cour de cassation sur le deuxième moyen relatif à la demande du salarié d'indemnisation de son droit au DIF, qu'il n'a pu exercer. Rappelons que l'article L. 6323-19 du Code du travail précise qu'en cas de licenciement, l'employeur est tenu d'informer le salarié dans la lettre de licenciement de la possibilité qui lui est ouverte de faire valoir ses droits en matière de droit individuel à la formation pendant la durée de son préavis. La Cour de cassation a reconnu au salarié un préjudice automatique en faveur du salarié pour lequel l'information des droits à la formation n'a pas été inscrite dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.409 : JurisData n° 2010-007845 ; JCP S 2010, 1296, note I. Beyneix). Par ailleurs, le ministre en charge du Travail a précisé qu'en cas de faute grave, dispensant le salarié de l'accomplissement de ce préavis, qu'il convenait d'admettre les droits du salarié à l'utilisation de son DIF dès lors qu'il en fait la demande pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable s'il n'avait pas été licencié pour faute grave (JCP S 2011, act. 94). Qu'en est-il en ce qui concerne ces droits en cas de la rupture du contrat de travail suite à la prise d'acte du salarié ? La Cour de cassation décide que « le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ».
Source
Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175, FS-P+B, M. J. c/ Sté John Deere : JurisData n° 2011-008897
19/05/2011
Justice
Une contribution des justiciables pour financer la garde à vue
Le projet de loi de finances rectificatif pour 2011 prévoit la création d'un nouveau droit d'enregistrement des instances en justice, affecté au financement de l'aide juridictionnelle.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, enregistré à l'Assemblée national le 11 mai 2011, il est précisé à l'article 20 que:
« La réforme de la garde à vue récemment approuvée par le Parlement va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l'aide juridique. Afin de financer cette nouvelle dépense dans une période budgétaire contrainte, le présent article institue une contribution pour l'aide juridique, destinée à assurer une solidarité financière entre l'ensemble des justiciables. Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 35 €.
Cette contribution ne sera pas due lorsque la partie bénéficiera de l'aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice ou ne répondrait pas à l'objectif de solidarité de la contribution. Elle n'est pas non plus exigible pour les affaires pénales.
Elle sera acquittée sous forme de droit de timbre mobile ou dématérialisé, soit par le justiciable soit par l'avocat pour le compte de son client, et est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) afin de financer les dépenses d'aide juridique.
Enfin, le III de l'article permet la récupération par l'État des sommes exposées au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat dès lors que la personne ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Une ouverture de 23 M€ sur le programme « Accès au droit et à la justice » de la mission « Justice » vient compléter le produit attendu de ce droit. Le texte prévoit ensuite le financement de travaux dans les commissariats et gendarmeries pour améliorer les conditions de garde à vue, qui se traduit par une ouverture de 15 millions d'euros sur les programmes de la mission « Sécurité ».
Le projet de loi sera discuté à compter du 6 juin devant l'Assemblée nationale.
Source
Projet de loi AN n° 3406, 11 mai 2011
18/04/2011
Procédure pénale
Garde à vue : application immédiate de la réforme
Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6, § 1, de la Convention EDH qui consacre le droit à l'assistance effective d'un avocat. L'assemblée plénière a statué sur deux questions :
- la première, sur le point de savoir si les dispositions de l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont conformes ou non à l'article 6 de la Convention EDH. L'assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l'article 63-4 du Code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 § 1. Elle a énoncé que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de EDH soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ».
- la deuxième question a trait à l'effet immédiat ou différé de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne. Après avoir rappelé que « les États adhérents à la Convention EDH sont tenus de respecter les décisions de la Cour EDH sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation », la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate. Les droits garantis par la Convention EDH devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d'une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
Dans un communiqué du même jour, la Chancellerie a précisé que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, également publiée le 15 avril 2011 au Journal officiel, avait fixé l'entrée en vigueur de ce texte au 1er juin 2011, que toutefois, le garde des Sceaux prenait acte des arrêts de l'assemblée plénière et que « des instructions précises sont immédiatement données aux magistrats du parquet pour que, sans attendre le 1er juin, les règles définies par la loi du 14 avril 2011 en matière de notification du droit au silence et de droit à l'assistance par un avocat soient appliquées sans délai, afin de garantir d'emblée la conformité des mesures prises aux exigences européennes ».
Source
Cass. ass. plén., 15 avr. 2011, n° P 10-17.049, F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242 L. n° 2011-392, 14 avr. 2011 : JO 15 avr. 2011, p. 6610
Min. Justice, 15 avr. 2011, communiqué
14/04/2011
Procédure Pénale
Adoption définitive du projet de réforme de la garde à vue
Le projet de loi réformant la garde à vue a été définitivement adopté, le 12 avril, sans modification, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale. Parmi ses principales dispositions, il faut retenir :
- l'introduction dans le Code de procédure pénale de la disposition suivante : « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ;
- le droit de garder le silence : la personne placée en garde à vue est informée de son droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ;
- la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures (la mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, dans certains cas) ;
- l'assistance de l'avocat et l'accès aux documents de la procédure : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat pour un entretien de 30 minutes. Désormais, l'avocat sera informé de la nature de l'infraction, il pourra consulter le PV de notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les PV d'audition du gardé à vue ;
-les auditions et confrontations : le droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions et confrontations est consacré, si la personne en fait la demande. L'avocat pourra prendre des notes mais aussi poser des questions aux termes de ces mesures. L'audition ne peut débuter sans la présence effective de l'avocat, avant un délai de carence de 2 heures, introduit par les députés (à moins que l'audition ne porte que sur les éléments d'identité) et seule une autorisation du procureur de la République peut permettre d'y déroger. L'avocat a la possibilité d'adresser des observations écrites au procureur dans lesquelles il consignera, s'il le souhaite, les questions refusées par l'enquêteur comme « étant de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête » ;
- le report de la présence de l'avocat : la présence de l'avocat peut être reportée « à titre exceptionnel », sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge de la liberté et de la détention (JLD), pendant une durée de 12 heures maximum, lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ». Lorsque la personne est gardée à vue pour des faits criminels, ou des délits encourant une peine supérieure ou égale à 5 ans, et sur autorisation du JLD, ce délai pourra courir jusqu'à la 24e heure. La consultation des PV d'audition peut alors, elle-aussi, être différée sous ces mêmes conditions. Par dérogation, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de 48 heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de 72 heures ;
- le contrôle de la garde à vue : la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du JLD, en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48e heure et de report de l'intervention de l'avocat ;
Le texte ne fait plus mention de « l'audition libre ».
Malgré cette adoption définitive, le monde judiciaire reste dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui devrait être rendue le 15 avril prochain par l'assemblée plénière au sujet de la conformité d'une mesure de placement en garde à vue au regard de l'article 6, §1, de la Conv EDH. En effet, suite au constat d'inconventionnalité des dispositions relatives à la garde à vue par le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC : JCP G 2010, 914), la Cour de cassation, dans ses arrêts du 19 octobre 2010 (Cass. crim., 19 oct 2010, n° 10-82.902, n° 10-85.051 et n° 10-82.306 : JurisData n° 2010-018565, n° 2010-018564 et n° 2010-018566 ; JCP G 2010, 1104) avait, jusqu'ici, seulement différé les effets de ce constat au 1er juillet 2011.
Source
Projet de loi AN, 12 avr. 2011, TA définitif n° 645
04/04/2011
QPC
Le remboursement des frais irrépétibles devant la Cour de cassation à la seule partie civile est contraire à la Constitution
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011, a jugé les dispositions de l'article s 618-1 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution.
Cet article, relatif aux remboursements des frais exposés en vue de l'instance, permet à la partie civile d'obtenir le remboursement de ces frais devant la Cour de cassation. Toutefois, le même droit n'est pas reconnu à la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif. Le Conseil constitutionnel a jugé que ceci porte atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation et donc au principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article. Dans ce délai, le législateur pourra ainsi choisir les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les parties au procès pénal quant au remboursement des frais liés à l'instance devant la Cour de cassation en matière pénale.
Source
Cons. const., déc. 1er avr. 2011, n° 2011-112 QPC Conseil constitutionnel, 1er avr. 2011, communiqué
23/03/2011
La « directive retour » est directement invocable par les justiciables
Saisi par le tribunal administratif de Montreuil, le Conseil d'État a répondu à la question suivante : la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite "directive retour. - JOUE n° L 348, 24 déc. 2008, p. 98), qui n'a pas été transposée en droit français dans le délai imparti est-elle directement invocable par les étrangers contestant une mesure de reconduite à la frontière ?
L'article 7 de la « directive retour » prévoit qu'une décision de reconduite à la frontière d'un étranger doit prévoir un délai approprié (de 7 à 30 jours) pour permettre le départ volontaire de l'étranger. La mesure d'éloignement ne pourra être exécutée qu'à l'expiration de ce délai. Le paragraphe 4 de l'article 7 prévoit également une réduction, voire une suppression du délai dans certaines hypothèses (risque de fuite, danger pour l'ordre public, etc.).
Le délai de transposition de cette directive a expiré le 24 décembre 2010 et le projet de loi comportant les dispositions de transposition est en cours d'examen au Parlement. Dans l'état actuel du droit, l'article L. 511-1, II du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aménage aucun délai pour le départ volontaire de l'étranger préalablement à l'exécution de la mesure d'éloignement. Était donc posée la question de la compatibilité des arrêtés de reconduite à la frontière pris depuis le 25 décembre 2010 avec la "directive retour".
Le Conseil d'État a considéré que les dispositions de la directive ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise sur le fondement de l'article L. 511-1, II du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, à la condition que cette mesure respecte les conditions de fond et de forme de la directive et qu'elle comporte dans tous les cas un délai minimal de 7 jours avant l'exécution de la mesure d'éloignement.
Se fondant sur les critères définis par le Cour de justice, le Conseil d'État a estimé que les dispositions des articles 7 et 8 de la "directive retour" étaient suffisamment précises et inconditionnelles pour avoir un effet direct en droit interne. Il a donc conclu que ces dispositions étaient susceptibles d'être invoquées par un justiciable contestant une mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet.
Le Conseil d'État a également précisé que tant que le droit national ne comporterait pas la définition de la notion de "risque de fuite" prévue par le 7) de l'article 3 de la directive, il ne pourrait invoquer ce risque pour justifier une réduction ou une suppression du délai de départ volontaire.
Source
CE, avis, 21 mars 2011, n° 345978 et 346612, MM. J. et T.
21/03/2011
Aide juridictionnelle
Adoption de nouvelles règles relatives à l'aide juridictionnelle
Le décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat emporte certaines modifications de la procédure relative à l'aide juridique.
Le décret précise que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'AJ est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande (D. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 43-1, créé par D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 5).
Le délai du recours ouvert à l'intéressé contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle qui était d'un mois est réduit à quinze jours (D. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 56, al. 1er, mod. D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 7).
Le décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéfice de l'AJ tout ou partie des dépens. Il crée également deux nouveaux articles qui organisent le sort des dépens en cas de désistement ou d'accord des parties mettant fin à l'instance (D. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 123-1 et 123-2, créés par D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 14. - V. aussi CPC, art. 696).
Le décret vient préciser la procédure applicable au nouveau régime de recouvrement de l'aide juridictionnelle instaurée par la loi de finances pour 2011 (L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010, mod. L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 44). Les sommes avancées par l'État au titre de l'AJ seront désormais soumises à la procédure de recouvrement des créances "ordinaires" de l'État déterminée par le décret du 29 décembre 1962 (D. n° 62-1587, 29 déc. 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique). Le recouvrement de ce type de créance nécessite l'émission d'un titre exécutoire. L'ordonnateur secondaire sera seul compétent pour émettre un ordre de recette, qui sera ensuite notifié par les comptables publics directement au redevable (D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 14 à 21).
Source
D. n° 2011-272, 15 mars 2011 : JO 17 mars 2011
14/03/2011
Fiscal
Suppression du taux réduit de TVA sur les prestations effectuées par les avocats et les avoués dans le cadre de l'AJ
Les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle étaient auparavant soumises au taux réduit de la TVA en vertu du f de l'article 279 du CGI.
En application de l'arrêt rendu par la CJUE le 17 juin 2010 (aff. C-492/08, Commission c/ France), le VII de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010) abroge ces dispositions. Par suite, les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010. Cette mesure harmonise le taux de TVA applicable à l'ensemble des prestations des avocats et des avoués, qu'elles soient effectuées dans le secteur libre ou dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Le fait générateur ayant lieu à l'exécution complète du service (CGI, art. 269-1-a), le taux normal est applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour lesquelles la date d'achèvement de la mission d'assistance figurant sur l'attestation de mission délivrée par le greffe, ou, à défaut, la date de délivrance de ladite attestation, intervient à compter du 31 décembre 2010. Cela étant, il est admis que le taux réduit s'applique aux provisions versées avant le 31 décembre 2010 à un avocat ou avoué agissant dans le cadre de l'aide juridictionnelle. DB supprimée : 3 C 2297.
Source
Instr. 18 févr. 2011 : BOI 3 C-1-11, 3 mars 2011
10/02/2011
Taux de l'intérêt légal pour 2011
Le décret n° 2011-137 du 1er février 2011 fixe à 0,38 % le taux de l'intérêt légal pour l'année 2011 (au lieu de 0,65 % pour 2010).
Le taux de l'intérêt légal est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines (C. monét. fin., art. L. 313-2). En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; il est également majoré de cinq points quatre mois après le prononcé du jugement d'adjudication sur saisie immobilière.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant (C. monét. fin., art. L. 313-3). Le taux de l'intérêt légal, qui est le même en matière civile et commerciale, sert également au calcul des intérêts moratoires dus par un débiteur après mise en demeure.
Le taux minimal des pénalités de retard exigibles en cas de retard de paiement (C. com., art. L. 441-6, réd. L. n° 2008-776, 4 août 2008) est fixé à 1,14 % pour l'année 2011 (taux non inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal).
Le taux de l'intérêt légal s'applique dans le domaine fiscal, notamment au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes additionnelles exigibles sur certaines mutations de propriété et apports en société. Toutefois, seule la première décimale est retenue soit, pour l'année 2011, un taux de 0,3 %. Un taux réduit de 0,1 % (taux réduit des deux tiers) peut trouver à s'appliquer en 2011 pour le paiement différé et fractionné des droits dus sur les transmissions d'entreprises, lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (CGI, Ann. III, 404 GA).
Source
D. n° 2011-137, 1er févr. 2011 : JO 3 févr. 2011, p. 2166
22/12/2010
Procédure civile
Saisie des rémunérations
Le décret n° 2010-1565 du 15 décembre 2010 remplace le barème des saisies et cessions des rémunérations de l'article R. 3252-2 du Code du travail. Il entre en vigueur le 1er janvier 2011.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit :
au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 € ;
au dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 € ;
au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 € ;
au quart, sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13 660 € ;
au tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € ;
aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 € ;
à la totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 330 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Source
D. n° 2010-1565, 15 déc. 2010 : JO 17 déc. 2010, p. 22234
09/12/2010
Droit du travail
Cass. Soc., 15 juin 2010 (pourvoi n° 09-65.062 et n° 09-65.064)
Mots-clés : licenciement pour motif économique - contestation - prescription abrégée (art. L. 1235-7 al. 2 C. trav.) - champ d'application
Commentaire : la Cour de cassation a rendu en juin dernier un arrêt important qui détermine le champ d’application de l’article L. 1235-7 al. 2 du Code du travail. Cette disposition, introduite dans le Code du travail par la loi du 18 janvier 2005, prévoit une prescription abrégée de 12 mois pour la contestation du licenciement pour motif économique. En raison d’une rédaction équivoque, il existait jusqu’à ce jour une réelle incertitude sur le domaine de cet article. Selon l’administration du travail et certaines juridictions du fond, la prescription de 12 mois s’appliquait à toutes les contestations d’un licenciement pour motif économique, quel que soit le type de licenciement concerné – individuel ou collectif – et le fondement de la contestation – fond ou procédure. D’autres juridictions du fond estimaient, à l’inverse, que seules étaient concernées les contestations ayant pour objet un licenciement décidé dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler un « grand licenciement économique collectif », c'est-à-dire d’un licenciement collectif frappant plus de 10 salariés sur une période de 30 jours dans une entreprise de plus de 50 salariés. Dans son arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation se prononce non seulement en faveur de cette dernière interprétation mais elle semble même aller plus loin.
En l’espèce, deux salariées contestent leur licenciement économique pour absence de cause réelle et sérieuse après l’expiration du délai de 12 mois prévu par l’article L. 1235-7 al. 2 du Code du travail. Les juges du fond font droit à leur demande au motif que la prescription abrégée ne vise que les « licenciements collectifs d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés et nécessitant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ». L’employeur se pourvoit en cassation. Opérant une substitution de motifs, la Haute juridiction rejette son pourvoi au terme d’un attendu qui paraît donner un champ d’application encore plus restreint à l’article L. 1235-7 al. 2 du Code du travail. En effet, la Cour de cassation affirme non seulement que cette disposition n’est applicable qu’aux licenciements intervenus dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mais aussi que, parmi les contestations relatives à ce type de licenciements, seules certaines d’entre elles doivent être exercées dans un délai d’un an : les « contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi ».
Ainsi, aux termes de cette décision, demeurent soumises à la prescription de droit commun de 5 ans, d’une part, la contestation des licenciements économiques pour lesquels l’employeur n’est pas tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi – licenciement individuel ou « petit » licenciement collectif (moins de 10 salariés sur trente jours ou moins de 50 salariés dans l’entreprise) – quelle que soit la nature des griefs formulés – violation d’une règle de procédure tout comme le non-respect d’une règle de fond –, mais aussi, d’autre part, la contestation d’un licenciement économique pour lequel l’employeur est tenu de mettre en place un PSE pour peu que la demande ne repose pas sur la nullité de la procédure de licenciement, voire sur la nullité de la procédure en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un PSE. Cette interprétation, qui conduit à exclure du domaine de la prescription abrégée toute contestation du licenciement économique pour un autre motif que la nullité de la procédure tenant à l’absence ou à l’insuffisance du PSE, a pu paraître à certains trop restrictive. L’article L. 1235-7 al. 2 vise en effet non seulement les contestations portant sur la « validité » du licenciement mais également celles qui portent sur sa « régularité ». Des auteurs ont donc prédit un retour prochainement à une interprétation moins restrictive.
En tout état de cause, le texte prévoit que le délai de 12 mois pour agir n’est « opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».
Précédents jurisprudentiels : circulaire DGTEFP-DRT n° 2005/47 du 30 décembre 2005 ; CA Limoges, 16 juin 2008, CA Chambéry, 4 juill. 2008 ; CA Douai, 29 mai 2009
07/12/2010
Immobilier
Mandat de recherche non exclusif : conditions du droit à rémunération
Une agence immobilière avait obtenu d'un couple de propriétaires la signature d'un mandat de vente non exclusif portant sur une villa au prix de 457 000 euros net vendeur. Un mois plus tard, elle a régularisé auprès d'un candidat acquéreur un mandat de recherche d'une maison individuelle pour un budget maximum de 420 000 euros.
Ce candidat acquéreur a visité, par l'intermédiaire de l'agence, la villa objet du mandat de vente et a signé une offre d'achat de l'immeuble au prix de 460 000 euros.L'acte authentique de vente n'ayant pas été établi, l'acquéreur pressenti a ultérieurement acquis ce bien par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier, à un prix inférieur.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2007) a cru pouvoir le condamner à payer à l'agence évincée la commission de 5 % prévue par le mandat de recherche, calculée sur la base du prix effectif d'achat, en affirmant que « lorsqu'un agent immobilier bénéficiaire d'un mandat de recherche en vue de l'acquérir fait visiter un immeuble et qu'ensuite l'acquéreur traite avec un autre mandataire du vendeur, l'opération est effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier ».
La Cour de cassation censure cette décision et énonce, au visa de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, que lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition.
Source
Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 08-12.432 : JurisData n° 2010-021986
25/11/2010
Pénal
Le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention EDH
Par un arrêt du 23 novembre 2010, non définitif, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France, en affirmant que le ministère public n'est pas une « autorité judiciaire » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention EDH. La Cour considère en effet que, les membres du ministère public en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». L'État a indiqué qu'il allait faire appel.
Dans cette affaire, une avocate au barreau de Toulouse avait été placée en garde à vue le 13 avril 2005 sur commission rogatoire délivrée par des juges d'instructions d'Orléans, dans le cadre d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants, pour soupçons de violation du secret de l'instruction, sur la base des déclarations de deux mis en examen. Après la fin de sa garde à vue, le 15 avril suivant, elle avait été présentée au procureur adjoint du TGI de Toulouse, en raison de l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a alors ordonné sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant lesdits juges. Le 18 avril, mise en examen après son interrogatoire de « première comparution » par ces juges d'instruction, le juge des libertés et de la détention ordonna sa détention provisoire. L'avocate avait ainsi été maintenue cinq jours en détention sans avoir été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'examiner le bien-fondé de sa détention, ces derniers s'étant strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie à son cabinet, à l'exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant son audition et la légalité de sa détention.
La requérante a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) pour violation de l'article 5 § 3 de la Convention aux termes duquel « toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) ». Le Gouvernement français arguait que l'avocate avait été présentée au procureur adjoint de Toulouse le 15 avril 2005, et qu'elle avait ainsi rencontré un magistrat indépendant appartenant à l'ordre judiciaire et gardien, au sens de la Constitution, des « libertés individuelles ».
Source
CEDH, 23 nov. 2010, req. n° 37104/06, Moulin c/ France
22/11/2010
Social
De la délégation de pouvoir de licencier dans les SAS
Dans deux arrêts rendus le 19 novembre 2010, la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, a mis fin à une incertitude affectant le régime juridique des sociétés par actions simplifiées (SAS), en se prononçant sur les conditions dans lesquelles les représentants statutaires de ce type de société pouvaient déléguer leur pouvoir de licencier. Cette question faisait l'objet d'un vif débat au sein des milieux économiques et juridiques. De la position adoptée par la Cour de cassation dépendaient d'importants enjeux, car les SAS sont, quantitativement, la première forme de sociétés par actions. Un grand nombre d'entre elles ont un poids économique considérable et emploient plusieurs milliers de salariés. Selon l'article L. 227-6 du Code de commerce, la SAS « est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...). Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ». Le débat portait sur le point de savoir si ces dispositions limitent aux seuls dirigeants statutaires de la SAS, c'est-à-dire le président directeur général et le directeur général, le pouvoir de licencier, ou si, comme dans les autres sociétés, cette prérogative peut être déléguée à un autre membre de l'entreprise. Dans les affaires soumises à la Cour de cassation, les sociétés par actions simplifiées ED et Whirlpool France avaient licencié des salariés par lettres recommandées signées, pour la première par le chef de secteur et le chef des ventes, pour la seconde par le responsable des ressources humaines. Les salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leurs licenciements. Ils estimaient notamment que les signataires de leurs lettres de licenciements n'étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, à défaut d'être bénéficiaires d'une délégation prévue par les statuts, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce. La cour d'appel de Versailles (arrêt du 5 novembre 2009) et la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3 déc. 2009 : JurisData n° 2009-379626 ; V. JCP S 2010, 1239, étude P. Morvan) ont accueilli leurs demandes, la première en condamnant l'employeur à réintégrer le salarié au motif que son licenciement était nul, la seconde en accordant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans deux arrêts du 19 novembre 2010, la chambre mixte de la Cour de cassation, composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale, a cassé les arrêts rendus par ces cours d'appel en jugeant que les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce n'excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Elle précise aussi qu'une telle délégation n'obéit à aucun formalisme particulier, qu'elle peut être ratifiée a posteriori, et peut résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines. La Cour de cassation met ainsi fin à une interprétation qu'elle considère comme erronée des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce, fondée sur une confusion entre le pouvoir général de représentation de la SAS à l'égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des SAS, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d'assurer le fonctionnement interne de l'entreprise.
Source
Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-10.095 et n° 10-30.215, P+B+R+I, SAS ED c/ P et a.
C. Cass., 19 nov. 2010, communiqué
17/11/2010
Social
Unicité de l'instance : revirement de jurisprudence
Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un important revirement quant aux conditions d'application de la règle dite de l'unicité de l'instance.
En l'espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud'hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce alors en vigueur. Constatant que ledit employeur ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le CPH avait alors invité l'intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, avant de prononcer un jugement en sa faveur condamnant son employeur. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 du Code du travail. Cet arrêt est cassé par la chambre sociale. Estimant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
Aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». Introduite par la loi du 27 mars 1907, cette disposition a notamment pour but d'éviter le risque d'éparpillement des procédures. Dans un communiqué de presse, la Cour de cassation affirme que « bien que critiquée par certains auteurs, la règle a toujours été appliquée avec rigueur par la chambre sociale qui l'a tout particulièrement réaffirmée, malgré l'avis contraire de son avocat général, dans un arrêt du 12 novembre 2003 qui rejetait un pourvoi faisant grief à une cour d'appel d'avoir déclaré la demande d'un salarié irrecevable alors que la précédente instance avait été annulée pour défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle et ce, alors qu'aucune décision au fond n'avait été rendue ». L'arrêt du 16 novembre 2010 opère un revirement de jurisprudence.
Source
Cass soc., 16 nov. 2010, n° 0970404
04/11/2010
Consommation
Volet surendettement de la loi du 1er juillet 2010 : entrée en vigueur le 1er novembre 2010
Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, portant application du volet surendettement de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, (JO 2 juill. 2010, p. 12001 : JCP G 2010, 858) est entré en vigueur le 1er novembre 2010. Les dispositions du décret s'appliquent aux procédures en cours sauf exceptions. Les principaux apports du texte concernet :
- le renforcement des droits des personnes inscrites au fichier FICP des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (V. A. 26 oct. 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : JO 30 oct. 2010, p. 19545).
Les délais d'inscription au fichier FICP sont réduits de 8 à 5 ans suite à une procédure de rétablissement personnel (les 5 ans commenceront à courir à compter de la date de clôture du jugement de PRP). La durée d'inscription au fichier FICP pour les personnes engagées dans un plan de remboursement d'une commission de surendettement sera réduite de 10 à 5 ans si la personne rembourse son plan sans incident. En cas d'incident, l'inscription sera prolongée sans que la durée totale d'inscription puisse dépasser 8 ans. La réduction des délais d'inscription est applicable aux personnes déjà inscrites au FICP (environ 120 000 personnes inscrites au fichier au titre du surendettement vont être désinscrites à partir du 1er novembre). Par ailleurs, un nouveau droit d'accès à distance aux informations FICP est créé. Chacun pourra interroger à distance la Banque de France pour savoir si il est inscrit au fichier et connaître la durée de son inscription ;
- accélération des procédures de surendettement : aujourd'hui, lorsqu'un dossier de surendettement est déposé à la Banque de France, la commission de surendettement dispose de 6 mois pour décider de sa recevabilité. Les procédures amiables dans le cadre des commissions de surendettement durent en moyenne 3,5 mois et celles de rétablissement personnel (PRP) en moyenne 16 mois. Désormais, la commission de surendettement disposera d'un délai de 3 mois pour décider de la recevabilité d'un dossier. Les personnes propriétaires de leur logement ne pourront plus être, du seul fait qu'elles sont propriétaires, exclues de la procédure de surendettement. Sont également prévus : la suspension automatique des voies d'exécution dès la recevabilité du dossier de surendettement ; la possibilité pour la commission, et en cas d'urgence pour le débiteur, de saisir le juge afin de prononcer la suspension des procédures d'expulsion du logement ; les commissions de surendettement pourront décider seules de mesures de rééchelonnement de dette et d'effacement d'intérêts.
Afin d'accélérer les procédures de rétablissement personnel (PRP), les commissions de surendettement pourront recommander aux juges les mesures d'effacement total ou partiel de dette en cas d'insuffisance d'actifs. Ces mesures prendront effet après leur homologation par le juge. Cette mesure devrait permettre de raccourcir la durée moyenne de 95 % des PRP de 1,5 an en moyenne à 6 mois. Enfin, pour favoriser le rebond des personnes connaissant des difficultés d'endettement, la durée maximale des plans et des mesures de surendettement sera réduite de 10 à 8 ans.
- améliorer les relations entre les banques et leurs clients surendettés : les banques qui assurent la tenue de comptes de personnes surendettées ne seront informées du dépôt du dossier devant la commission qu'à la date où sa recevabilité est prononcée ; elles ne pourront plus procéder au remboursement direct du découvert utilisé qui sera en quelque sorte « gelé » et inclus dans la procédure de surendettement. Le non respect du principe de non remboursement des dettes antérieures sera sanctionné par une nullité prononcée par le juge.
Source
D. n° 2010-1304, 29 oct. 2010 : JO 31 oct. 2010, p. 19604
A. 26 oct. 2010 : JO 30 oct. 2010,p. 19545
Minefe, 1er nov. 2010, communiqué
04/11/2010
Social
Changement de rythme de travail et modification substantielle des contrats
Trois salariés, ayant initialement été contractés verbalement par une société de ménage, reçoivent le 31 mars 1998 un contrat de travail formalisant leurs relations. Le 26 novembre suivant, elles reçoivent un nouveau courrier de l'employeur, intitulé « règles de travail », instaurant notamment le temps de travail alloué par type de tâche, et fixant à une heure le temps qu'elles doivent consacrer au nettoyage d'une cage d'escalier. En 2006, la société leur signifie un nouveau planning, dans lequel elle n'alloue plus que trois quart d'heure pour cette même tâche. Les salariées refusent cette modification du rythme de travail, et l'employeur les licencie. Elles saisissent alors la juridiction prud'homale pour faire reconnaître ces licenciements comme abusifs, au motif que le courrier fixant le temps de travail alloué à chaque tâche était selon elles « annexé » au contrat, et que la modification du planning constituait par conséquent une modification unilatérale des contrats de travail.
La cour d'appel, puis la Cour de cassation, refusent le caractère abusif des licenciements. D'une part, le courrier du 26 novembre ayant été envoyé postérieurement et indépendamment des contrats de travail, il n'en constitue pas une annexe, quand bien même il y fait référence.
D'autre part, « rien ne permettait de retenir une quelconque répercussion de la modification de la cadence de travail litigieuse sur la rémunération ou le temps de travail des salariées ». Il s'agit par conséquent là d'« un simple changement de leurs conditions de travail » et non d'une modification substantielle de leurs contrats, et les licenciements s'en trouvent fondés.
Source
Cass. soc., 20 oct. 2010, n° 08-44.594, n° 08-44.595 et n° 08-44.596, FS-P+B, Sté Strend c/ Mas et a. : JurisData n° 2010-018924
28/10/2010
Public
Le portrait de Pétain à Gonneville-sur-Mer ne doit pas orner la salle du conseil municipal
Le tribunal administratif de Caen vient de confirmer l'obligation de la commune de décrocher le portrait de Philippe Pétain installé dans la salle du conseil municipal.
En dépit de la demande du préfet du Calvados du 21 janvier 2010, le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer avait refusé de décrocher le portrait de Philippe Pétain placé dans la salle des délibérés du conseil municipal de la commune. Saisi par le préfet d'une requête à fin d'annulation de cette décision, le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet par un jugement rendu le 26 octobre 2010.
Le tribunal retient deux motifs d'annulation : il juge que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Le tribunal n'a pas retenu l'argumentation de la commune selon laquelle le portrait de Philippe Pétain qui n'était pas installé seul, trouvait sa place dans une galerie de portraits historiques des chefs de l'Etat depuis 1871, en raison de la portée symbolique particulière que revêt le portrait de Philippe Pétain.
Le tribunal estime également que la décision de refus de décrocher le portrait qui est signée par la maire émane en réalité du conseil municipal alors que celui-ci n'a pas été réuni dans les formes et selon les modalités prévues par les articles L. 2121-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à la demande du préfet, le tribunal enjoint au maire de décrocher le portrait de Philippe Pétain dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son jugement.
Source
TA Caen, 26 octobre 2010, n°1000282, Préfet du Calvados : JurisData 2010-019215.
28/10/2010
Règlement intérieur
Une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale
Au visa des articles L. 1321 1 et L. 1331 1 du Code du travail et après avoir rappelé que lorsque le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur, la Cour de cassation pose le principe qu' « une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ».
En l'espèce, un salarié ayant tenu des propos diffamatoires est sanctionné par son employeur par une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés. Le salarié saisit le juge afin de contester cette sanction dont il invoque la nullité, à défaut d'être prévue par le règlement intérieur de l'entreprise. Pour refuser d'annuler cette sanction et décider que l'employeur pouvait, eu égard à la faute commise, prononcer une mise à pied de cinq jours, même si le règlement intérieur de la société ne comportait pas de dispositions limitant dans le temps une telle sanction et ne pouvait être utilement invoqué, les juges du fond retiennent qu'une telle sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l'autorité judiciaire.
La Cour de cassation désapprouve les juges du fond et accueille la demande du salarié.
Source
Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42.740, P-B-R-I, Sté S c/ X C. cass., 26 oct. 2010, communiqué
21/10/2010
Responsabilité médicale
Cass. 1ère Civ., 3 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.591)
Mots-clés : devoir d'information du médecin - manquement - réparation nécessaire
Commentaire : l’arrêt du 3 juin 2010 constitue un important revirement – il a même été qualifié d’historique par le célèbre magistrat de la Cour de cassation Pierre Sargos – par rapport à une décision critiquée du 6 décembre 2007. La Haute juridiction décide en effet que le défaut d’information du médecin constitue en lui-même un préjudice réparable sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a causé un dommage au patient. Auparavant, la jurisprudence exigeait que le manquement au devoir d’information ait fait perdre à ce dernier une chance de renoncer à l’acte médical. Il en résultait que, lorsque, au vu des risques encourus en l’absence d’intervention médicale, la probabilité de voir le malade renoncer au traitement qui lui était proposé était négligeable, la responsabilité du médecin ne pouvait être engagée.
La portée de cette nouvelle solution apparaît nettement au vu des faits de l’espèce. Un homme subit une adénomectomie prostatique sans avoir été informé au préalable des risques d’impuissance liés à ce type d’intervention chirurgicale. Le risque se réalise et il assigne son médecin. Devant les juges du fond son action est rejetée au motif qu’il ne démontre pas que le manquement du médecin à son devoir d’information lui a causé un préjudice. En effet, la cour d’appel relève, d’une part, qu’il n’existait aucune alternative au traitement proposé et, d’autre part, que, au regard des dangers auxquels il s’exposait en l’absence d’intervention, il était peu probable que, même dûment informé, le patient ait refusé le traitement qui lui était proposé. Ainsi, le manquement du médecin à son devoir d’information ne lui avait fait perdre qu’une chance négligeable d’échapper aux conséquences dommageables de l’intervention ce dont il résultait, sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, que le patient n’avait subi aucun préjudice réparable. Tel n’est plus le cas depuis l’arrêt du 3 juin 2010.
La solution nouvelle doit sans doute être approuvée dans la mesure où elle permet de renforcer le droit du patient à être informé des risques qu’il encourt, et ce, même si le traitement proposé semble inévitable. Elle constitue néanmoins une originalité dans la mesure où, en l’absence de préjudice, la sanction du manquement du médecin à son obligation d’information ressortit davantage d’une logique de peine privée que d’une logique de réparation.
Précédents jurisprudentiels : Cass. 1ère Civ., 7 févr. 1990 (pourvoi n° 88-14.797) ; Cass. 1ère Civ., 20 juin 2000, (pourvoi n° 98-23.046) ; Cass. 1ère Civ., 13 nov. 2002 (pourvoi n° 01-00.377) ; Cass. 1ère Civ., 6 déc. 2007 (pourvoi n° 06-19.301)
21/10/2010
Procédure pénale
La Cour de cassation juge la garde à vue non conforme à la Convention EDH
Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. La chambre criminelle estime que la personne placée en garde à vue doit être effectivement assisté par un avocat dès le début de la mesure, quelle que soit la nature de l'infraction. Cette jurisprudence ne pourra toutefois s'appliquer qu'à compter du 1er juillet 2011.
Régimes dérogatoires. - À la différence du Conseil constitutionnel, lequel avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'examen de la constitutionnalité des régimes dérogatoires, deux des trois décisions rendues par la Cour de cassation concernent ces régimes. La Haute juridiction estime que la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du Code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction. De plus, la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence et doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer.
Adopté en Conseil des ministres le 13 octobre, le projet de loi relatif à la garde à vue porte exclusivement sur le régime de droit commun. Le garde des Sceaux a indiqué que « pour les régimes dérogatoires, (...) le Gouvernement tiendra évidemment compte de ces décisions et complètera le texte du projet de loi par voie d'amendement. Cela concernera bien sûr la notification du droit au silence et la nécessité de motiver au cas par cas le report de la présence de l'avocat pour une raison impérieuse, et non pas seulement en raison de la nature de l'infraction ».
Application dans le temps. - Dans un communiqué, la chambre criminelle explique s'être trouvée dans une situation juridique inédite : la non-conformité à la Convention EDH de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs déclarés, en grande partie, inconstitutionnels par le Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps (Cons. const., déc. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC : JCP G 2010, act. 914, Aperçu rapide par F. Fournié ; Procédures 2010, repère , 9 ; V. égal. Cons. const., déc. 22 sept. 2010, n° 2010-31 QPC). Dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré le régime de droit commun de la garde à vue contraire à la Constitution, tout en reportant les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 afin de permettre au Parlement de procéder à des modifications des textes. En conséquence, les mesures prises avant cette date « ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité », avait indiqué le Conseil (V. JCP G 2010, 961).
La chambre criminelle a donc décidé que « ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice (...), ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ».
Source
Cass. crim., 19 oct. 2010, FP P+B+I+R, n° 10-82.902 : JurisData n° 2010-018565 Cass. crim., 19 oct. 2010, FP P+B+I+R, n° 10-82.306 : JurisData n° 2010-018566 Cass. crim., 19 oct. 2010, FP P+B+I+R, 10-82.051 : JurisData n° 2010-018564
C. cass., 19 oct. 2010, communiqué
Min. Justice, 19 oct. 2010, communiqué
15/10/2010
Procédure civile
Disparition des avoués en 2012
L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Le texte prévoit la disparition de la profession d'avoué et sa fusion avec la profession d'avocat au 1er janvier 2012. Les députés ont notamment précisé : « Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission (...) notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation ». En cas d'acceptation de l'offre, l'indemnité est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation. « Trois mois avant l'entrée en vigueur de la loi, les avoués près les cours d'appel pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés ».
Source
Projet de loi AN, 2e lecture, 13 oct. 2010, TA mod. n° 543
14/10/2010
Procédure pénale
Projet de loi relatif à la garde à vue
Le ministre de la Justice a présenté un projet de loi relatif à la garde à vue en Conseil des ministres du 13 octobre. Il s'agit du premier volet de la réforme de la procédure pénale.
Le texte fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution.
Michèle Alliot-Marie a affirmé que le texte visait à « réduire le recours à la garde à vue et à améliorer les droits des personnes qui en font l'objet, sous le contrôle renforcé du procureur de la République ». Le texte affirme le principe selon lequel la seule nécessité d'entendre une personne suspectée au cours d'une enquête n'impose pas son placement en garde à vue. Il fixe le cadre juridique d'une audition libre, s'agissant notamment du recueil du consentement de la personne à être librement entendue.
Les conditions de la garde à vue sont énumérées de façon précise et limitative. Elle n'est pas possible pour les crimes ou les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, et ne peut être prolongée que pour les délits punis d'au moins un an d'emprisonnement.
La personne gardée à vue se verra notifier son droit de garder le silence.
L'assistance de la personne gardée à vue par un avocat est élargie sur deux points : l'avocat aura accès aux procès-verbaux d'audition de son client ; il pourra assister à toutes les auditions de la personne, dès le début de la mesure. Le procureur de la République pourra toutefois différer l'exercice des ces deux nouveaux droits pendant une durée maximale de douze heures, en raison de circonstances particulières faisant apparaître la nécessité, en urgence, de rassembler ou de conserver les preuves ou de prévenir une atteinte imminente aux personnes. Il s'agira donc en pratique d'hypothèses exceptionnelles.
Enfin, le projet de loi garantit le respect de la dignité des personnes gardées à vue, notamment en interdisant de façon absolue qu'au titre des mesures de sécurité, il soit procédé à des fouilles à corps intégrales.
Source
Cons. min., 13 oct. 2010
14/10/2010
Famille
Précisions sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire
En vertu de l'article 271 du Code civil, le juge, lorsqu'il se prononce sur l'opportunité et le montant d'une prestation compensatoire peut prendre en considération plusieurs éléments et notamment la « durée du mariage » ou encore « le patrimoine (...) des époux tant en capital qu'en revenu ». C'est sur ces deux éléments d'appréciation que la Cour de cassation est amenée à se prononcer, dans un arrêt du 6 octobre 2010 (Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-12.718).
En l'espèce, une épouse, ayant vu sa demande de prestation compensatoire rejetée par les juges du fond, reproche à la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 6 janv. 2009) d'avoir uniquement pris en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, ignorant la durée de la vie commune antérieure, alors même qu'un enfant était né pendant cette période. Considérant ce moyen comme n'étant pas fondé, la Cour de cassation précise que « pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ».
L'arrêt d'appel est, en revanche, cassé et annulé sur un autre point. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, les juges du fond ont retenu que cette dernière perçoit des prestations familiales à hauteur de 802 euros et un revenu mensuel de 529 euros au titre du congé parental, soit 1331 euros mensuels. Or, la Cour de cassation, n'adoptant pas le même raisonnement, considère que : « les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ». Ils ne doivent donc pas être pris en compte lors du calcul de la prestation compensatoire.
Source
Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-12.718
12/10/2010
Famille
Les perspectives successorales exclues du calcul de la prestation compensatoire
Par deux arrêts du 6 octobre 2010, la Cour de cassation se prononce sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire, notamment sur la question de la prise en compte des perspectives successorales.
Dans une première espèce (Cass. 1re civ., n° 09-10.989), déboutant l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2008) avait retenu que celle-ci avait vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle était déjà nue-propriétaire. Ce patrimoine, évalué à 804 930 €, devait être partagé avec sa soeur. Partant, la cour d'appel avait estimé que « dans un avenir prévisible, ses revenus [seraient] identiques à ceux de son mari » et qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une prestation compensatoire.
L'arrêt est cassé par les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, dans un attendu de principe, considèrent que « la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil ». En effet, en vertu de ces articles, le juge accorde la prestation compensatoire en tenant compte, notamment, de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or, pour la Cour de cassation, en prenant en compte des éléments « non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci de caractère prévisible », la cour d'appel a violé lesdits articles.
C'est d'ailleurs ce qu'elle confirme dans une seconde espèce (Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-15.346), lorsqu'elle déclare que : « la cour d'appel n'avait pas à tenir compte des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari » pour fixer la prestation compensatoire due par le mari.
Source
Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-10.989 et n° 09-15.346
04/10/2010
Sociétés
La faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle commise par un gérant de SARL est nécessairement séparable de ses fonctions
Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
Des époux ont confié à une entreprise de bâtiment la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant ; des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées. Faisant valoir que la gérante avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, les époux l'ont assignée en paiement de dommages intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société.
A violé l'article L. 223-22 du Code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du Code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, a retenu que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant et ajouté que la société a négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu penser fût ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier et que seul le contrat finalement signé après le début des travaux a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé, alors qu'il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs.
Source
Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255, Épx X c/ Mme Y
01/10/2010
Contrats
Effet rétroactif de l'annulation d'une décision de préemption
Une société avait conclu une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive du non-exercice des droits de préemption par ses titulaires respectifs. La commune ayant préempté, elle est devenue acquéreur de l'immeuble et l'a ensuite rétrocédé. . Le bénéficiaire évincé de la promesse a fait annuler pour excès de pouvoir la décision de préemption et a demandé en conséquence l'annulation des ventes successives.
La cour d'appel (Paris, 2 avr. 2009) l'a débouté de sa demande en retenant que la rétroactivité de l'annulation de la décision de préemption avait pour effet la réalisation de la condition suspensive. De ce fait, le bénéficiaire aurait dû procéder à la levée de l'option, faute de quoi la promesse était devenue caduque et il n'était donc plus fondé à demander l'annulation des ventes postérieures.
La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt.
Source
Cass. 3e civ., 22 sept. 2010, n° 09-14.817 : JurisData n° 2010-016514
28/09/2010
QPC
Garde à vue en matière de terrorisme : constitutionnalité du régime dérogatoire
Le Conseil constitutionnel a jugé que les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, qui définissent les conditions dans lesquelles le juge des libertés peut autoriser une prolongation de la garde à vue jusqu'à une durée maximale de six jours, ne portent atteinte à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Une telle dérogation ne peut en effet être mise en œuvre qu'à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée, et est en outre décidée par le juge des libertés.
Source
Cons. const., déc. 22 sept. 2010, n° 2010-31 QPC
16/09/2010
Interdiction de la burqa : adoption définitive du projet de loi
Le Parlement a définitivement adopté, le 14 septembre, le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (v. JCP G 2010, act. 706 ; JCP G 2010, act. 142). « Eu égard à la portée de ce texte », les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont décidé de soumettre « conjointement et dans les mêmes termes » la loi à l'examen du Conseil constitutionnel, « afin que sa conformité à la Constitution ne puisse être affectée d'aucune incertitude ».
Lors de l'examen du projet de loi, la garde des Sceaux a défendu le texte devant les sénateurs. Michèle Alliot-Marie a rappelé que le principe d'une interdiction générale de la dissimulation du visage sur l'espace public reposait sur un fondement constitutionnel : « l'ordre public social », lequel exprime « les valeurs fondamentales du pacte social au nom desquelles des mesures d'interdiction générales peuvent être prises ». Pour la ministre, la notion est explicite dans la jurisprudence du Conseil d'État, plus implicite dans celle du Conseil constitutionnel, ce qui ne l'empêche pas d'être reconnue.
Le texte sanctionne désormais la dissimulation du visage sous un voile intégral qu'elle soit contrainte ou volontaire. Volontaire, la méconnaissance de l'interdiction prévue par la loi est constitutive d'une contravention de deuxième classe, sanctionnée par une amende d'un montant maximum de 150 €. Un stage de citoyenneté peut être substitué ou prescrit en complément à la peine d'amende. La dissimulation forcée du visage conduit à des sanctions plus conséquentes. Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes « de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ». Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
L'interdiction est générale et absolue, toutefois le texte prévoit des exceptions, notamment pour certaines activités nécessitant la dissimulation du visage dans l'espace public, sans pour autant porter atteinte à l'ordre public social, ou, a indiqué le garde des Sceaux, lorsque les situations « sont compatibles avec les principes du vivre ensemble ».
Le texte prévoit une entrée en vigueur du texte six mois après son adoption, afin de permettre, dans ce délai, « un effort de pédagogie à l'égard des personnes concernées ».
Source
Sénat, 1re lecture, 14 sept. 2010, TA définitif n° 161
Sénat, 15 sept. 2010, communiqué
Min. Justice, 7 sept. 2010, discours
31/08/2010
Surendettement des particuliers
Loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (n° 2010-737)
Commentaire : la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2010 (art. 61 IV), a modifié le régime du surendettement des particuliers avec trois objectifs : accélérer le traitement des dossiers, améliorer la protection du débiteur surendetté et simplifier le déroulement de la procédure.
Ainsi, les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement prévues à l’article L. 330-1 du Code de la consommation demeurent pour l’essentiel inchangées. La seule innovation de la loi du 1er juillet 2010 concerne les personnes qui sont propriétaires de leur logement. Cette situation ne suffit plus, à elle seule, à les exclure du bénéfice de la procédure de surendettement. Contrairement à ce que décidaient certaines commissions de surendettement, la loi prévoit désormais que « le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » (art. 44).
Afin d’accélérer le traitement des dossiers de surendettement, le législateur a réduit le délai imparti aux commissions pour statuer sur la demande : aux termes de l’article L. 331-3 (nouveau), elles disposent désormais de 3 mois (art. 40 L. 1er juillet 2010) contre 6 mois auparavant. Si, à l’issu de ce délai, la commission n’a toujours pas statué, le taux d’intérêt des emprunts du débiteur est, en principe, ramené au taux d’intérêt légal (art. 40 L. 1er juillet 2010). Toujours dans le même souci de célérité, le législateur autorise désormais la commission, lorsqu’elle juge réunies les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement, à en avertir tous les créanciers par fax ou par mail. Ce mode d’information était jusque-là réservé aux seuls établissements de crédit, établissements de paiement et comptables (ancien art. L. 331-3 al. 6).
Une innovation importante de la loi du 1er juillet 2010 résulte de l’instauration d’un arrêt automatique des poursuites individuelles contre le débiteur surendetté. Jusqu’à présent, l’article L. 331-5 (ancien) prévoyait seulement que cette mesure pouvait être sollicitée par la commission auprès du juge de l’exécution. Désormais le nouvel art. L. 331-3-1 dispose que « la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ». Des restrictions sont toutefois prévues. D’abord, cette mesure a une durée limitée à un an maximum. Ensuite, certaines mesures d’exécution échappent à l’arrêt automatique des poursuites. Tel est le cas de la saisie immobilière lorsque la vente forcée a été ordonnée (art. L. 331-3-1 nouveau) ou de l’expulsion dont la suspension doit être spécialement demandée par la commission (ou son président, en cas d’urgence) au juge de l’exécution (art. L. 331-3-2 nouveau). En contrepartie, le débiteur voit son patrimoine « gelé ». Il lui est en effet interdit « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » et notamment de payer une créance antérieure autre qu'alimentaire sans y avoir été autorisé par le juge (art. L. 331-3-2 al. 2 et 3 nouveau).
Dernière innovation notable de la loi du 1er juillet 2010, les pouvoirs de la commission ont été considérablement renforcés. En effet, si sa mission demeure la conciliation des parties, elle peut désormais, lorsque ces dernières ne parviennent pas à se mettre d’accord, leur imposer elle-même une série de concessions qu’elle devait auparavant solliciter auprès du juge de l’exécution. Au nombre de ces mesures figurent par exemple le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements d’abord sur le capital ou encore la réduction du taux d’intérêt (art. L. 331-7).
21/08/2010
Droit du travail
Cass. Soc., 2 juin 2010 (pourvoi n° 09-41.416)
Mots-clés : contrat de chantier - qualification - CDD – non
Le contrat dit de chantier est en principe un contrat de travail à durée indéterminée ce qui n’est pas toujours avantageux pour le salarié. Contrairement à ce que cette qualification pourrait laisser penser, le terme de ce type de contrat est convenu dès le jour de sa conclusion. En effet, l’article L. 1236-8 du Code du travail autorise ainsi l’employeur à licencier le salarié en fin de chantier.
Si la Cour de cassation ne rejette pas par principe la requalification du contrat de chantier en CDD, elle exige néanmoins que les conditions de validité de ce type de contrat soient réunies. Ainsi, il faut non seulement que le contrat relève de l’un des cas pour lesquels le recours au CDD est admis (art. L. 1242-2 du Code du travail) mais aussi que ce motif figure dans le contrat écrit comme l’impose l’article L. 1242-12 du Code de travail. Or, en l’espèce, si la première condition était bien remplie – il s’agissait d’un chantier à l’étranger pour lequel le recours au CDD est d’usage selon l’article D. 1241-1, 10° –, la seconde faisait défaut. La Cour de cassation applique donc la sanction de droit commun prévue pour ce type de cas, à savoir la qualification du contrat en CDI. La solution n’est toutefois pas pleinement satisfaisante dans la mesure où cette sanction permet en principe au bénéficiaire d’accéder à un régime plus protecteur. Or, s’agissant du contrat de chantier, l’une des principales dispositions protectrices du salarié en matière de CDI, à savoir la nécessité de justifier d’une cause réelle et sérieuse pour y mettre fin, est neutralisée par l’article L. 1236-8 C. du trav. qui autorise le licenciement en fin de chantier.
Précédents jurisprudentiels : Cass. Soc., 16 mai 1961 (Bull. n° 528) ; Cass. Soc., 5 déc. 1979 (pourvoi n° 78-40913) ; Cass. Soc., 7 mars 2007 (pourvoi n° 04-47059)
30/07/2010
Communiqué de presse du Conseil constitutionnel - 2010-14/22 QPC
Constitutionnalité de la garde à vue
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 1er et 11 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées par M. Daniel W et 35 autres requérants. Ces questions portent sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale (CPP) relatifs au régime de garde à vue.
I - Sur le régime de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants... : articles 63-4, alinéa 7, et article 706-73 du CPP.
Les articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du CPP, issus de la loi du 9 mars 2004, mettent en place un régime particulier de garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisées. La durée totale de la garde à vue peut notamment être portée jusqu'à 96 heures.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il avait jugé ces dispositions conformes à la Constitution à l'occasion de l'examen de la loi du 9 mars 2004 par la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. En l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, et en application de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, il ne peut donc être posé de QPC sur ces dispositions « déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil ».
Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de procéder à un nouvel examen de ces dispositions.
II - Sur le régime de droit commun de la garde à vue : articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du CPP.
Dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les modifications apportées aux articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du CPP alors soumises à son examen. Toutefois, depuis lors, une évolution des règles et des pratiques a contribué à un recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures.
La proportion des procédures soumises à une instruction préparatoire représente désormais moins de 3% des dossiers. Dans le cadre du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales, une personne est aujourd'hui le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue. Celle-ci est devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause. Enfin, le nombre des officiers de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000.
Ces modifications des circonstances de droit et de fait ont contribué à ce que plus de 790 000 gardes à vue aient été décidées en 2009. Elles justifient que le Conseil constitutionnel procède à un réexamen de la constitutionnalité des articles 62, 63, 63-1, 64-4, alinéas 1er à 6, et 77 du CPP.
La garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire. Toutefois les évolutions depuis 1993 doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue et assurant la protection des droits de la défense. Or toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant 24 heures renouvelables, quelle que soit la gravité des faits. L'intéressé ne bénéficie pas de l'assistance effective d'un avocat. Il en va ainsi sans considération des circonstances susceptibles de justifier cette restriction pour conserver les preuves ou assurer la protection des personnes alors que, au demeurant, l'intéressé ne reçoit pas même la notification de son droit de garder le silence.
Le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions attaquées n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée. Le Conseil a donc jugé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.
L'abrogation immédiate de ces dispositions aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entrainé des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Comme pour la décristallisation des pensions (n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010), il a donc reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 avec, comme conséquence, que les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Ce délai, durant lequel les règles en vigueur continuent à s'appliquer, doit permettre au Parlement de choisir les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée.
20/07/2010
Famille
Violences familiales : création de l'ordonnance de protection et modification du dispositif de l'autorité parentale
On retiendra de la loi n° 2010 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2010, l'insertion au sein du Code civil d'un titre XIV complétant le livre Ier intitulé « des mesures de protection des victimes de violence » applicable à compter du 1er octobre 2010 (C. civ., art. 515-9 à 515-13). La loi du 9 juillet 2010, qui contient pas moins de 38 articles, comporte également des dispositions particulières relativement à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant applicables immédiatement.
Ordonnance de protection du juge aux affaires familiales - Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. Cette ordonnance est délivrée par le juge si celui-ci estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
Signalons qu'une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé (C. civ., art. 515-13).
Contenu de l'ordonnance -A l'occasion de la délivrance de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales est notamment compétent pour :
- statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement (sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences) ;
- attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
- se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
- et prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse (en application de l'article 20, alinéa 1er , de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (C. civ., art. 515-9 et 515-10).
La loi du 9 juillet 2010 supprime, en conséquence, le troisième alinéa de l'article 220-1 du Code civil prévoyant les mesures relatives au logement, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage que peut prendre le juge en cas de violences exercées par l'un des époux et qui mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants.
Durée des mesures - Les mesures de l'ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de quatre mois et peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée (C. civ., art. 515-12). Sauf modification du juge, le dépôt d'une requête initiale en divorce ne suspend pas l'effectivité de ces mesures (C. civ., art. 257).
Exercice de l'autorité parentale et résidence de l'enfant - Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9).
Complétant l'article 373-2-11 du Code civil, la loi du 9 juillet 2010 prévoit que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Retrait de l'autorité parentale - Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés :
- soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant,
- soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant,
- soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent (C. civ., art. 378).
Délégation de l'autorité parentale - Désormais, un membre de la famille (et non plus seulement le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant) peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale en cas de désintérêt manifeste des parents ou si ceux-ci sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale (C. civ., art. 377, al. 2).
Mesures diverses. Pour mémoire, nous indiquons que des mesures particulières sont également prévues pour ce qui concerne l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant (C. civ., art. 375-7 et 373-2-6 ; L. art. 3). Ajoutons que le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité (C. pén., art. 222-33-2-1).
Source
L. n° 2010-769, 9 juill. 2010 : JO 10 juill. 2010, p. 12762
14/07/2010
Responsabilité
Faute de la victime et faute du notaire conduit à un partage de responsabilité
Un établissement de crédit ayant consenti à des emprunteur un prêt pour l'achat d'un immeuble, avait chargé un notaire de procéder à l'inscription à son profit d'une hypothèque de premier rang. Or, en contradiction avec les termes de l'acte, la banque a remis les fonds au promoteur et non au notaire. Après la révalation lors de la saisie contre les emprunteurs défaillants de deux hypothèques primant la sienne, la banque a assigné le notaire en responsabilité.
La cour d'appel (CA Montpellier, 24 février 2009) a cru pouvoir accéder à sa demande et a conclu à la seule responsabilité du notaire au motif que la faute de la banque (l'absence de remise des fonds à la comptabilité de l'étude notariale) n'étant ni irrésistible, ni imprévisible, aurait pu être évitée si le notaire lui-même n'avait pas commis une faute en ne s'abstenant de contrôler la réception des fonds.
La Haute juridiction censure cette décision : la faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, à la réalisation du dommage emportait un partage de responsabilité (violation par la cour d'appel de l'article 1382 du code civil).
Source
Cass. 1e civ. 1er juill. 2010, pourvoi n° 09-13.896, JurisData n° 2010-010548
13/07/2010
Droit de la famille
Violences familiales : création de l'ordonnance de protection et modification du dispositif de l'autorité parentale
On retiendra de la loi n° 2010 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2010, l'insertion au sein du Code civil d'un titre XIV complétant le livre Ier intitulé « des mesures de protection des victimes de violence » applicable à compter du 1er octobre 2010 (C. civ., art. 515-9 à 515-13). La loi du 9 juillet 2010, qui contient pas moins de 38 articles, comporte également des dispositions particulières relativement à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant applicables immédiatement.
. Ordonnance de protection du juge aux affaires familiales - Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. Cette ordonnance est délivrée par le juge si celui-ci estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
Signalons qu'une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé (C. civ., art. 515-13).
. Contenu de l'ordonnance -A l'occasion de la délivrance de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales est notamment compétent pour :
- statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement (sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences) ;
- attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
- se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
- et prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse (en application de l'article 20, alinéa 1er , de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (C. civ., art. 515-9 et 515-10).
La loi du 9 juillet 2010 supprime, en conséquence, le troisième alinéa de l'article 220-1 du Code civil prévoyant les mesures relatives au logement, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage que peut prendre le juge en cas de violences exercées par l'un des époux et qui mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants.
. Durée des mesures - Les mesures de l'ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de quatre mois et peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée (C. civ., art. 515-12). Sauf modification du juge, le dépôt d'une requête initiale en divorce ne suspend pas l'effectivité de ces mesures (C. civ., art. 257).
. Exercice de l'autorité parentale et résidence de l'enfant - Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9).
Complétant l'article 373-2-11 du Code civil, la loi du 9 juillet 2010 prévoit que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
. Retrait de l'autorité parentale - Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés :
- soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant,
- soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant,
- soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent (C. civ., art. 378).
. Délégation de l'autorité parentale - Désormais, un membre de la famille (et non plus seulement le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant) peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale en cas de désintérêt manifeste des parents ou si ceux-ci sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale (C. civ., art. 377, al. 2).
. Mesures diverses. Pour mémoire, nous indiquons que des mesures particulières sont également prévues pour ce qui concerne l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant (C. civ., art. 375-7 et 373-2-6 ; L. art. 3). Ajoutons que le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité (C. pén., art. 222-33-2-1).
Source
L. n° 2010-769, 9 juill. 2010 : JO 10 juill. 2010, p. 12762
08/07/2010
Cass. Soc., 26 mai 2010 (pourvoi n° 08-43.152)
Matière : harcèlement au travail
Mots-clés : notion de harcèlement moral – agissements sur une brève période – exclusion – non
Commentaire : si un seul acte isolé, tel une rétrogradation par exemple, ne permet pas de caractériser un harcèlement car, à la différence de la violence ou de l’agression sexuelle, cette notion suppose des agissements répétés, rien ne s’oppose à ce que des faits constitutifs de harcèlement moral se déroulent sur une brève période.
Au retour d’un arrêt maladie, un salarié est rétrogradé à un poste le cantonnant à l’exécution de tâches subalternes et subit des menaces et des propos dégradants de la part de son employeur. Les juges du fond refusent néanmoins de considérer le harcèlement moral comme constitué car, peu de temps après sa reprise, le salarié est à nouveau arrêté, de sorte que c’est uniquement pendant un court laps de temps qu’il a été contraint de subir les agissements de son patron.
La Chambre sociale casse l’arrêt d’appel : en estimant que, parce que les évènements s’étaient déroulés au cours d’une très brève période, ils étaient insuffisants pour caractériser un harcèlement moral, les juges du fond ont ajouté une condition à la loi. La Cour de cassation confirme par là son interprétation stricte de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
06/07/2010
Europe
Les CDD conclus en vue du remplacement de salariés absents peuvent ne pas comporter les noms de ces travailleurs et les raisons de leur remplacement
La CJUE considère que la clause 8, point 3, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (V. Cons. CE, dir. 1999/70/CE, 28 juin 1999, annexe), ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui a supprimé l'obligation, pour l'employeur, d'indiquer dans les contrats à durée déterminée conclus en vue du remplacement de travailleurs absents les noms de ces travailleurs et les raisons de leur remplacement, et qui se limite à prévoir que de tels contrats à durée déterminée doivent être écrits et doivent indiquer les raisons du recours à ces contrats, pour autant que ces nouvelles conditions sont compensées par l'adoption d'autres garanties ou protections ou qu'elles n'affectent qu'une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
La clause 8, point 3, de l'accord dispose en effet que sa mise en oeuvre « ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par [cet] accord ».
La CJUE précise également que, dès lors que cette clause est dépourvue d'effet direct, il appartient à la juridiction de renvoi, dans le cas où elle serait amenée à conclure à l'incompatibilité de la législation nationale en cause au principal avec le droit de l'Union, non pas d'en écarter l'application mais de lui donner, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à la directive 1999/70 et à la finalité poursuivie par ledit accord-cadre.
Source
CJUE, 4e ch., 24 juin 2010, aff. C-98/09, Sorge c/ Poste Italiane SpA
30/06/2010
Étrangers
Conditions de délivrance la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire »
Le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur les demandes de travailleurs étrangers tendant à l'annulation d'arrêtés par lesquels le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de ses arrêtés et a prévu qu'ils pourraient être reconduits à la frontière à destination du pays dont ils ont la nationalité, a décidé de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'État, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) la seule circonstance que l'étranger présente une promesse d'embauche ou un contrat de travail dans un métier figurant ou non sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 constitue-t-elle un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « salarié » ?
2°) le préfet de police, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger se prévalant d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche dans un métier figurant ou non sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, est-il tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du Code du travail ?
Le Conseil d'État a rendu son avis le 8 juin.
Il considère tout d'abord que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'Emploi et de l'Immigration du 18 janvier 2008.
En cas de demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
L'article L. 313-14 ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait. Il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée.
Sur la seconde question, le Conseil d'État considère que ni l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du Code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée.
Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 susvisé n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le Code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail. Il s'ensuit que, à Paris, le préfet de police n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du Code du travail. La demande d'autorisation de travail pourra, en tout état de cause, être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
Source
CE, avis, 8 juin 2010, n° 334793, Sacko et a. : JurisData n° 2010-008791
18/06/2010
Social
Contestation d'un licenciement et prescription
La chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée pour la première fois sur le champ d'application de l'alinéa 2, de l'article L. 1235-7, du Code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Dans cette affaire, deux salariés avaient saisi, plus d'un an après leur licenciement pour motif économique, un CPH pour contester la validité de celui-ci. Pour rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, qui avait jugé que leur demande n'était pas prescrite, la chambre sociale juge que « le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi » et non, comme en l'espèce, à une contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Source
Cass. soc., 15 juin 2010, FS-P+B+R, n° 09-65.062 / 09-65.064, Rejet
Cour de cassation, 15 juin 2010, communiqué
17/06/2010
Pénitentiaire
Conditions de détentions à la prison Bonne-Nouvelle : nouvelle condamnation de l'État
Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, par ordonnance du 11 juin 2010, condamné l'État à verser des provisions à 38 personnes détenues à la maison d'arrêt de Rouen, pour incarcération dans des conditions portant atteintes à la dignité humaine. Ont à l'appui de cette condamnation été notamment mis en avant, dans des cellules de 10 à 13 m2, l'absence de ventilation spécifique du cabinet d'aisance et de cloisonnement véritable avec la pièce principale, ces cabinets étant en outre situés à proximité du lieu de prise de repas tolérée par l'Administration pénitentiaire. Étant donnée de surcroît la longueur des peines auxquelles sont condamnés les détenus incarcérés dans cette maison d'arrêt, la surpopulation carcérale et l'absence de respect de l'intimité des requérants qui en résulte, le juge conclut à la méconnaissance de l'article D. 189 du Code de procédure pénale, qui prescrit au service public pénitentiaire d'assurer le respect de la dignité inhérente à la personne humaine à l'égard des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Une précédente ordonnance de référé du tribunal administratif de Rouen condamnant l'État pour détention dans des conditions indignes dans ce même établissement avait été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2009 (JurisData n° 2009-013375).
Source
TA Rouen, ord. réf., n° 1000674, 11 juin 2010 : JurisData n° 2010-008800
14/06/2010
Social
La demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps plein n'est soumise à aucun formalisme
La Cour de cassation juge qu'il résulte des articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du Code du travail que « les conditions de forme prévues en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, ne s'appliquent qu'à la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel et que la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps plein n'est en revanche soumise à aucun formalisme ».
En l'espèce, le temps de travail d'une salariée a été réduit à sa demande par un avenant à son contrat de travail précisant qu'elle bénéficierait lorsqu'elle le souhaiterait, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. Soutenant que son employeur n'avait pas respecté cette priorité d'emploi, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de dommages-intérêts.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Douai a énoncé que la demande orale présentée par la salariée n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail (devenu C. trav., art. L. 3123-8) puisqu'il n'était pas fait état d'une date précise pour la mise en oeuvre du nouvel horaire de travail ni du respect du délai de six mois, et qu'ainsi l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à cette demande. Cette décision est cassée.
Source
Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.395, FS-P+B, de Coninck c/ SAS Plovier textile : JurisData n° 2010-007848
11/06/2010
Responsabilité
Manquement d'un praticien à son obligation d'informer le patient des risques inhérents à l'intervention
Après avoir subi une adénomectomie prostatique, un patient recherche la responsabilité de son urologue en raison de l'impuissance survenue après l'intervention. Ce dernier aurait failli à son obligation de suivi postopératoire et manqué à son devoir d'information quant aux risques résultant de l'opération.
La cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 9 avr. 2008) le déboute de ces demandes. D'une part, parce qu'elle considère que « le suivi avait été conforme aux données acquises de la science », sauf négligence imputable au demandeur.
D'autre part, même si elle relève le manquement du médecin à son devoir d'information, la cour d'appel n'en tire aucune conséquence, considérant que même si le patient avait été correctement informé des risques, il est « peu probable » qu'il n'eût pas recouru à l'intervention.
C'est sur ce deuxième point que l'arrêt est cassé. En effet, la Haute juridiction confirme l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire, mais retient la responsabilité délictuelle du praticien en raison du manquement à son devoir d'information. Selon ses termes, « le non-respect du devoir d'information [résultant des articles 16 et 16-3, alinéa 2 du Code civil] cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, le juge ne peut laisser sans réparation ». En rupture avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation semble donc considérer que l'absence d'information du patient cause dans toute hypothèse un préjudice à ce dernier. L'indemnisation sur la base d'une perte de chance, évaluée au terme de critères stricts, semble donc délaissée, ouvrant la voie à une réparation systématique du préjudice, sans doute moral, du patient.
Source
Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591, FS P+B+R+I : JurisData n° 2010-00798
11/06/2010
Pénal
Lutte contre la polygamie de fait
Le ministre de l'Intérieur souhaite « faire évoluer notre droit » pour pouvoir lutter plus fermement contre certains comportements : « polygamie de fait », perception injustifiée de prestations sociales, qui, selon lui, ne sont aujourd'hui « pas suffisamment réprimées ».
La définition que le Code pénal fait de la polygamie « n'est pas adaptée à la réalité d'aujourd'hui » a indiqué Brice Hortefeux : la polygamie, c'est le fait de se marier civilement alors qu'on est déjà marié civilement. Cette définition a pour conséquence que personne ou presque n'est juridiquement polygame en France. Le droit ne tient pas compte des mariages religieux ni des situations de communauté de vie et d'intérêts qui constituent, en réalité, une « polygamie de fait », organisée pour qu'un homme vive des prestations sociales perçues par ses femmes. La « polygamie de fait » concernerait 16 à 20 000 familles.
Le ministre n'exclut pas non plus une adaptation du droit de la nationalité.
Source
Min. Intérieur, 9 juin 2010, discours
01/06/2010
Social
Modification de la rémunération contractuelle du salarié sans son accord = justification de la prise d'acte
Au visa des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que « le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ». Dès lors, elle considère que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dont la rémunération contractuelle a été modifiée sans son accord est justifiée.
En l'espèce, après avoir saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, un salarié a pris acte de la rupture le 12 mai 2005 reprochant à son employeur diverses modifications unilatérales de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne sa rémunération.
Pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que « si le plafonnement du potentiel annuel de primes 2005 constituait indiscutablement une modification unilatérale de sa rémunération, illicite en ce qu'elle ne pouvait intervenir sans son accord, ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas suffisamment grave pour autoriser l'intéressé à rompre brutalement son contrat de travail dans la mesure où, en fin de compte, il était assuré d'une rémunération qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à l'ancienne ».
Source
Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409, FS-P+B, Bozio c/ Sté Compagnie européenne des peintures Julien : JurisData n° 2010-005340
26/05/2010
Discriminations
Égalité hommes-femmes : l'interruption de carrière pour congé parental et l'emploi à temps partiel ne peuvent constituer des motifs légitimes de différenciation
La cour d'appel de Paris, dans une décision du 5 mai 2010, a condamné un employeur à verser plus de 350 000 € d'indemnités à une de ses ex-salariées pour discrimination en raison du sexe, de la grossesse et de la situation de famille. La salariée, mère de famille, avait saisi la HALDE car elle estimait avoir été victime de discrimination : à son retour de congé parental d'éducation, elle n'avait pas retrouvé un poste similaire mais avait été affectée à un poste moins valorisant, avec une rémunération inférieure. Elle n'avait en outre pas pu bénéficier de formation de remise à niveau, ni de bilan de compétences. Après enquête, la HALDE avait constaté l'existence d'une discrimination salariale liée au genre, à la grossesse et à la situation de famille (Délib. n° 2009-404, 14 déc. 2009) et avait présenté ses observations devant la cour d'appel en mars 2010. La cour a jugé que « la société défenderesse ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier de l'inégalité générale de traitement entre hommes et femmes au sein de l'entreprise, ni au cas particulier de [la salariée], du retard dans l'évolution de sa carrière et de la stagnation de sa rémunération alors que l'interruption de sa carrière pour congé parental et son emploi à temps partiel ne peuvent constituer des motifs légitimes de différenciation tant au regard du droit interne que des principes découlant du droit communautaire ». Ces éléments « caractérisent suffisamment la situation de discrimination, qu'il s'agisse des conditions de sa réintégration, du montant de sa rémunération et de l'évolution de sa carrière à l'issue de son congé parental ce qui rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ».
Source
CA Paris, 5 mai 2010, n° 06/05388, X c/ GIE BNP Paribas : JurisData n° 2010-006095
25/05/2010
Successions
Limite des pouvoirs du mandataire posthume
La défunte, mère de deux enfants mineurs, avait de son vivant institué un mandataire posthume à l'effet de « faire tous les actes d'administration et de gestion de toute sa succession pour le compte et dans l'intérêt de ses héritiers ».
Le père de ces derniers, administrateur légal sous contrôle judiciaire, a été autorisé à accepter purement et simplement la succession en leur nom et a demandé au juge des tutelles l'autorisation de vendre l'appartement dépendant de la succession, vente à laquelle le mandataire posthume s'est opposé.
Les juges du fond (TGI Créteil, 4 nov. 2008) ont cru pouvoir accueillir la demande du mandataire posthume en retenant notamment que son pouvoir de gestion impliquait la possibilité de s'opposer à la vente.
La Cour de cassation censure solennellement la décision en rappelant, au visa des articles 812, 812-1, 812-4 et 389-3, alinéa 3, du Code civil, que les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1er, et 812-1 du Code civil ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code.
Source
Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556 : JurisData n° 2010-005870
21/05/2010
Etat des Personnes
Adjonction du nom du père
Par un arrêt du 7 mai 2010, la Cour de cassation se prononce sur une demande de changement de nom en application des dispositions transitoires de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003.
En l'espèce, V. X.., né en 1992, avait été reconnu en mairie par sa mère, G. X. et devant notaire, par J. Y. décédé en 2001. Par requête du 28 juin 2006, Mme X. a, au nom de son fils mineur, sollicité du JAF, en application de l'article 334-3 du Code civil, l'adjonction du nom du père.
Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 23 oct. 2008) de l'avoir déboutée de sa demande. Elle se prévaut expressément de l'article 334-3 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, ainsi que de la loi 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi 2003-516 du 18 juin 2003. La demanderesse entendait se fonder sur les dispositions transitoires de la loi du 4 mars 2002, permettant l'accolement des deux noms des parents sur déclaration conjointe de ceux-ci et sollicitait l'autorisation du juge en raison du décès prématuré du père.
La Cour de cassation estime « qu'examinant la demande de changement de nom dont elle était saisie, sans dénaturer l'argumentation développée par l'appelante, la cour d'appel a exactement retenu qu'aux termes des articles 11 et 13 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, relative au nom de famille, les dispositions de fond de ce texte ainsi que celles de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, n'étaient pas applicables aux enfants qui, comme V., étaient nés avant janvier 2005 et que la situation de ces derniers était donc régie par le droit antérieur et plus particulièrement par les articles 334-2 et 334-3 anciens du Code civil, dans leur rédaction de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 qui, s'ils permettaient de substituer le nom d'un parent à celui de l'autre, n'autorisaient pas l'adjonction de ces deux noms ».
La Cour ajoute que « Mme X. n'a jamais soutenu devant les juges du fond que sa demande ne tendait qu'à pallier le décès du père grâce à une autorisation du juge pour pouvoir souscrire la déclaration prévue à titre transitoire par l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, tel que modifié par l'article 11 de la loi du 18 juin 2003, et qu'au demeurant « ces dispositions ne permettaient l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui n'avait pas transmis le sien que par une déclaration conjointe des deux parents à l'officier d'état civil ».
Le pourvoi est rejeté.
20/05/2010
Divorce
Conditions de report des effets du divorce
La Cour de cassation se prononce sur une demande de report des effets du divorce par un arrêt du 12 mai 2010.
En l'espèce, pour rejeter la demande de l'époux tendant au report des effets du divorce, l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2008) retient que par jugement définitif le TGI de Marseille a débouté l'épouse de sa demande et l'époux de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, l'époux n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du Code civil étaient remplies.
Au visa de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004439 du 26 mai 2004, aux termes duquel « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report », la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de report des effets du divorce formée par l'époux en application de l'article 262-1. La Haute juridiction précise en effet que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute. La cour d'appel a ainsi confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux.
Source
Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 08-70.274, F P+B+I : JurisData n° 2010-005875
20/05/2010
Filiation
Action en recherche de paternité et délai de prescription
Par un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation juge que « le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du Code civil pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance ».
En l'espèce, Mme Z. a donné naissance en 1964 à un garçon, qui a été reconnu par M. L. X. et légitimé par le mariage de celui-ci avec Mme Z. Les époux ont divorcé le 29 juin 1970.
Par actes d'huissier des 12 et 16 septembre 2003, le garçon a fait assigner sa mère, l'ex-époux et M. Y. en contestation de la paternité de l'ex-époux et en déclaration de la paternité naturelle de M. Y. Un jugement avant dire droit du 17 mai 2005 a dit l'action recevable et ordonné une expertise génétique à laquelle M. Y. a refusé de se soumettre. Un jugement du 16 janvier 2007 a annulé la reconnaissance effectuée par l'ex-époux et dit que M. Y. était le père naturel du garçon et que ce dernier porterait le nom de Y.
L'arrêt attaqué (CA Aix en Provence, 27 mars 2008) a confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la reconnaissance de l'ex-époux et la légitimation subséquente et déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité au motif, qu'enfermée dans un délai de deux ans à compter de la majorité de l'enfant, l'action engagée en 2003 par le garçon, majeur depuis 1982, était prescrite.
Ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité à l'égard de M. Y alors que « si l'action en recherche de paternité peut être exercée par l'enfant dans le délai de deux ans suivant sa majorité, elle est irrecevable lorsqu'il existe une reconnaissance établissant une autre filiation qui n'a pas été contestée au préalable, action recevable dans le délai de trente ans suivant la majorité de l'enfant, de sorte que dans cette hypothèse, le délai de deux ans n'est pas opposable. En ayant opposé la prescription de l'action en recherche de paternité après avoir constaté que l'action en contestation de reconnaissance introduite concomitamment était recevable, la cour d'appel a violé les articles 338 et 340-4 du Code civil. Dans un troisième moyen, il invoque l'article 13 de la Convention EDH qui garantit le droit à un recours effectif.
La Cour de cassation juge que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en ses deux dernières. Le pourvoi est rejeté.
Source
Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.636, FS P+B+I : JurisData n° 2010-005872